Éditos de Pascal Boniface
29 septembre 2025
« Rivalités pour la paix. Géopolitique de l’ONU » – 4 questions à Arthur Boutellis
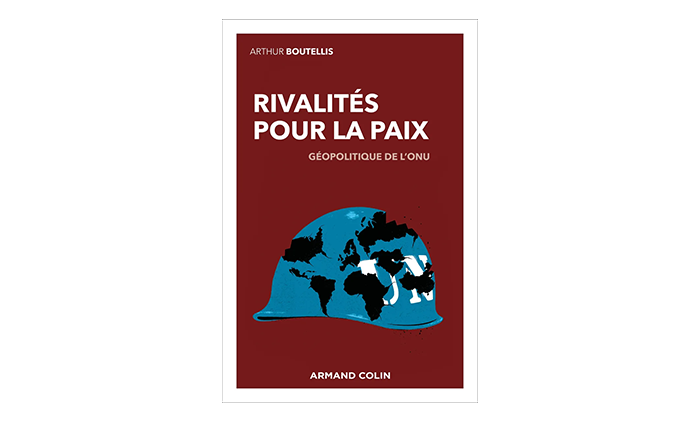
Arthur Boutellis est docteur en science politique, conseiller senior à l’International Peace Institute (IPI) et enseigne à l’université Columbia à New York et à Sciences Po Paris. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage Rivalités pour la paix. Géopolitique de l’ONU aux éditions Armand Colin.
La France est-elle toujours un acteur majeur dans le dispositif des Casques bleus ?
La France est encore un acteur majeur dans le maintien de la paix onusien et un de ses principaux champions, mais la question est : pour combien de temps encore ?
La France a réussi à conserver la tête du département des opérations de paix à New York depuis 1997 (malgré des velléités de la Chine de le lui prendre en 2016). Elle tient la « plume » au Conseil de sécurité sur environ un tiers des résolutions mandatant ces opérations de paix (et joue donc un rôle clef dans l’écriture et la négociation des mandats) et est le deuxième contributeur de troupe derrière la Chine parmi les membres permanents du Conseil grâce à sa contribution à la FINUL au Sud Liban. Cette position lui a permis de « multilatéraliser » ses intérêts, notamment en Afrique où étaient déployés le plus gros des opérations de paix ces 30 dernières années, parfois avec des « forces parallèles » françaises (Licorne en Côte d’Ivoire, Artemis en RDC, EUFOR au Tchad, Sangaris en Centrafrique, Serval/Barkhane au Mali) et contribue à son statut de puissance mondiale.
Néanmoins, sa contribution ou quotepart au budget du maintien de la paix n’est plus que de 4.6%. Le départ des bases françaises et la perte d’influence en Afrique, la fermeture annoncée de la FINUL en 2027 et la crise politico-financière à laquelle les Casques bleus sont confrontés posent la question de l’avenir du rayonnement français via le maintien de la paix. Le fait que les dirigeants politiques français ne s’y intéressent pas toujours, n’envoyant par exemple aucun ministre à la Conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix 2025 de Berlin plus tôt cette année, n’aide pas non plus, alors que c’est aussi une façon de montrer son attachement au multilatéralisme au-delà des discours…
La Chine devient-elle de plus en plus présente ?
La Chine est sans aucun doute l’acteur dont le pouvoir et l’influence se font le plus ressentir à l’ONU. Le futur de l’institution dépend certainement en grande partie de Pékin au moment où l’administration américaine dédaigne et coupe les vivres à l’Organisation mondiale. Depuis 2015 en particulier, la Chine a une attitude plus entreprenante et elle a énormément investi dans l’ONU dans son ensemble y compris dans ses opérations de paix.
Au départ, sa participation aux opérations de paix était un moyen de rassurer sur son « essor pacifique » et de donner l’image d’une « grande puissance responsable », mais c’est devenu une affirmation de sa puissance et de son influence. Alors qu’en 2000, la Chine ne déployait que 500 Casques bleus (venant d’unités de soutien), sa contribution est maintenant montée à 3 000 militaires (incluant depuis 2013 des unités d’infanterie « combattantes »). Dans le même temps, sa contribution au budget est passée de seulement 1% à près de 24 % du budget des opérations de maintien de la paix égalant presque celle des États-Unis.
Il n’est donc pas surprenant que Pékin entende aujourd’hui peser plus au sein de l’organisation, obtenir plus de postes à responsabilité dans les opérations et au siège des Nations Unies à New York et y promouvoir sa vision du monde et du multilatéralisme. La préoccupation est qu’elle y conteste les dimensions libérales du maintien de la paix et y promeut un respect plus strict de la souveraineté des États, une vision qui trouve d’ailleurs un écho parmi beaucoup de pays du « Sud global ». Mais ce n’est pas du goût de tous et on a vu par exemple une levée de boucliers quand à l’automne 2024, Pékin, qui a opéré un dégel diplomatique progressif avec les talibans, a indiqué vouloir prendre la « plume » sur l’Afghanistan et la mission de paix dans le pays (la MANUA). La Chine était prête à partager la plume avec un membre élu au Conseil, le Pakistan, mais les États-Unis s’y sont fermement opposés.
Quelles sont les marges de manœuvre du secrétaire général ?
C’est une vraie question et le sujet d’intenses débats ces jours-ci alors que se prépare la campagne pour la sélection du ou de la prochaine secrétaire générale pour janvier 2027 ! Aujourd’hui le secrétaire général António Guterres et l’ONU sont souvent marginalisés politiquement sur les dossiers de paix et sécurité internationales. Ils peinent à trouver un rôle autre qu’humanitaire pour l’Organisation dans un contexte de rivalités géopolitiques exacerbées. De la Syrie à la Birmanie, de l’Éthiopie à l’Ukraine, du Soudan à Gaza, l’ONU est largement impuissante à prévenir tout comme à résoudre les conflits de ces dernières années. L’ONU a largement perdu son rôle de « médiateur en chef impartial » des conflits et de plus en plus d’États puissants, ou aspirant à le devenir, voient en la médiation un nouvel outil d’influence pouvant servir leurs intérêts.
Il est vrai qu’António Guterres n’aura pas eu des mandats faciles. Il fait d’abord face en 2017 aux menaces de la première administration Trump, puis au COVID et au début de son second mandat à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité. Guterres dénonce alors fermement cette violation de la Charte des Nations Unies et Moscou le marginalise en réponse. L’ONU réussira bien à conclure un accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes et russes en juillet 2022, mais cet accord ne tiendra qu’un an.
Ce serait pourtant une erreur pour l’ONU de délaisser les processus politiques malgré le contexte géopolitique difficile. L’histoire nous enseigne que c’est précisément quand le Conseil de sécurité était bloqué dans un contexte de Guerre froide à partir des années 1950 que des secrétaires généraux et le secrétariat de l’ONU ont vu leur rôle grandir quand ils ont su faire preuve de realpolitik et ont été capables de parler aux intérêts des grandes puissances. On pense bien sûr au suédois Dag Hammarskjöld qui envoie les premiers « soldats de la paix » lors de la crise de Suez en 1956 puis au Congo, au birman U Thant pendant la crise des missiles de Cuba de 1962 (un excellent livre Peacemaker écrit par son petit-fils vient d’ailleurs de paraitre) ou encore au Péruvien Pérez de Cuéllar qui a joué un rôle important de « bons offices » dans des différends impliquant les membres permanents du Conseil de sécurité dans les années 1980.
Avec Donald Trump, l’avenir des forces de maintien de la paix est-il compromis ?
Oui, et au-delà des forces de maintien de la paix, c’est l’avenir de l’Organisation elle-même qui est en question. L’ONU fait face à une crise existentielle alors que la superpuissance américaine qui avait en grande partie édicté les règles onusiennes les conteste désormais, se désengage et coupe les vivres à l’Organisation. Les agences humanitaires onusiennes ont perdu près de 40% de leurs financements et les États-Unis n’ont pas payé leur quotepart de 25%pour les opérations de paix cette année (et ne semblent pas avoir l’intention de la payer), forçant António Guterres à annoncer des coupes de 20%de la masse salariale du secrétariat de l’ONU d’ici 2026 (l’initiative ONU80). L’administration Trump s’est également lancée en croisade contre le « wokisme » sur le plan lexical dans les documents onusiens, suggérant qu’à l’avenir, l’administration américaine pourrait adopter des positions plus proches de celles de la Chine et de la Russie que de celles des puissances moyennes libérales sur certaines de ces questions normatives.
Dans son discours à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies le 23 septembre 2025, Donald Trump n’a pas fait mention des Casques bleus, affirmant : « J’ai mis fin aux guerres à la place des Nations unies. » Cela dit, même si le Conseil de sécurité n’a créé aucune nouvelle opération de paix de grande envergure depuis 2014, il y a encore 60 000 Casques bleus déployés à travers le monde, contribuant à stabiliser des situations complexes de l’est de la RDC au Sud Liban ou encore Chypre. Et même les États-Unis continuent de voir un intérêt dans certaines de ces opérations de paix, notamment celle au Soudan du Sud (MINUSS). Washington sollicite également en ce moment même l’autorisation du Conseil de sécurité pour la création d’une nouvelle « Force de répression des gangs » en Haïti et un bureau de soutien de l’ONU pour lui apporter un soutien logistique. Les opérations de paix de l’ONU restent ainsi, malgré les défis, une option dans un certain nombre de crises où les grandes puissances ont un intérêt à ce que la situation soit stabilisée, mais pas assez pour qu’elles veuillent y envoyer leurs propres soldats ou assumer seules le coût d’une coalition.

