Entretiens / Observatoire du Maghreb
14 avril 2025
Relations franco-algériennes : derrière la désescalade des tensions, quels enjeux ?
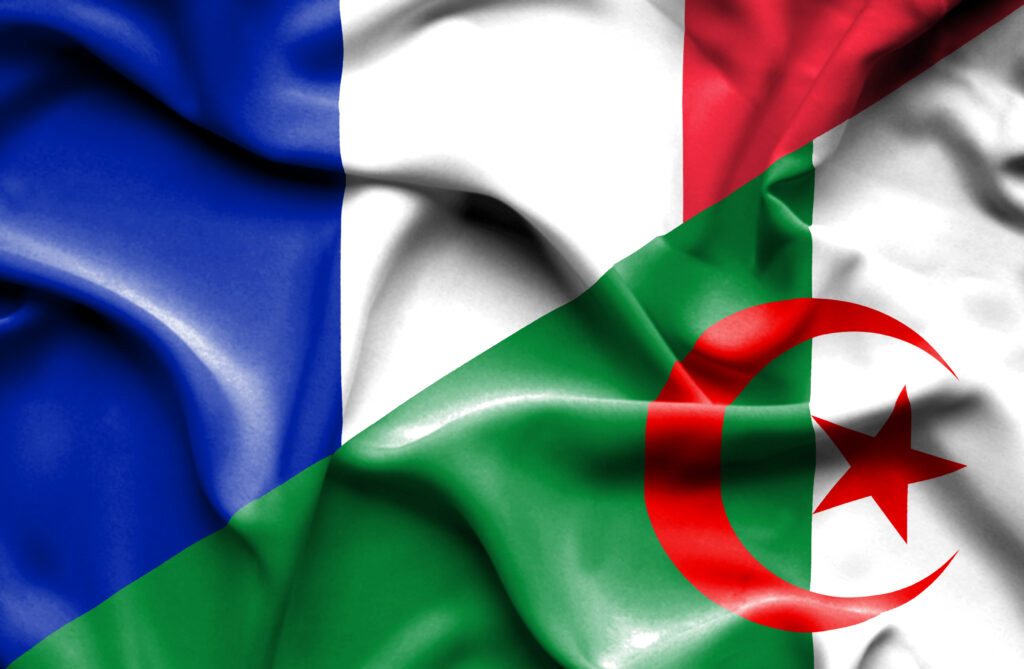
Alors qu’une crise diplomatique oppose Paris et Alger notamment suite à la décision d’Emmanuel Macron, en octobre 2024, d’apporter son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les échanges ont récemment repris, laissant entrevoir une désescalade progressive des tensions. Quelles sont les motivations bilatérales derrière ce rapprochement diplomatique ? Dans quels contextes intérieurs cette crise s’inscrivait-elle ? Quels sont les enjeux stratégiques qui gravitent autour de la politique extérieure des deux pays ? Le point avec Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS où il dirige l’Observatoire du Maghreb.
Comment analysez-vous le réchauffement des relations diplomatiques franco-algériennes, après 8 mois de crise inédite ? Dans quelle mesure, les enjeux de politique intérieure de part et d’autre pèsent-ils dans les dynamiques ?
La crise actuelle entre Alger et Paris est la plus grave depuis 1962. Marquée à la fois par la virulence inédite dans le ton et les propos, mais aussi par la longévité de la crise qui dure maintenant depuis huit mois environ. Ces tensions trouvent leurs racines dans le revirement d’Emmanuel Macron, favorable au plan d’autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Un dossier déjà au cœur des tensions entre Alger et Rabat, dont les relations diplomatiques sont rompues depuis 2021.
Cette crise diplomatique a été depuis juillet dernier, exacerbée par l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal et la question des ressortissants algériens sous OQTF qu’Alger refuse de reprendre. Deux sujets qui ont cristallisé les tensions et les débats médiatiques, notamment en France, exaltées par ailleurs par l’affaire des « influenceurs » algériens et l’attaque de Mulhouse.
Nous ne sommes pas encore au niveau du réchauffement des relations diplomatiques, mais plutôt dans un processus de désescalade. Entamé par un échange téléphonique d’abord entre les deux chefs d’État, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, et la visite du ministre des Affaires étrangères français Jean-Louis Barrot à Alger le 6 avril. Ces avancées marquent une forme de pragmatisme de la part des deux chefs d’État, une volonté de gérer la crise en dehors des sorties politico-médiatiques et de la surenchère privilégiée par une partie du gouvernement français, dont Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, s’est porté comme chef de file.
Bien évidemment, cette crise arrive dans un contexte aussi fragilisé par la sensibilité des relations franco-algériennes, notamment en raison du passé colonial qui a engendré des relations singulières entre les deux pays, marquées par la présence d’une importante population franco-algérienne diverse ou de Français liés à l’Algérie de différentes manières : harkis, pieds-noirs, juifs d’Algérie, mariages entre Français et Algériens, etc. Cette singularité crée des relations quasi intimes entre les deux pays, et favorise une confusion entre politique étrangère et politique intérieure de part et d’autre.
Côté algérien, cette crise s’inscrit dans un contexte sensible marqué par l’instabilité régionale et une fragilité liée à la faible légitimité électorale du scrutin de septembre 2024, caractérisé par un taux d’abstention record. Dans ce cadre, le rappel récurrent des tensions liées au passé colonial — notamment à travers les médias publics — vise à renforcer le sentiment nationaliste et à rallier le soutien autour du gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune.
Côté français, ces tensions ont lieu dans un cadre de crise politique inédite, aggravée depuis la dissolution du Parlement par Emmanuel Macron. À cela s’ajoute la sensibilité au sein d’une partie de la classe politique française sur les questions liées à l’Algérie, notamment dans les cercles de droite dure et d’extrême droite qui s’appuient sur une volonté de surfer sur la crise actuelle entre Paris et Alger afin d’assurer leur présence médiatique, et de séduire une partie de l’électorat en perspective de candidature — à la fois pour les présidences de partis, notamment chez Les Républicains, mais aussi pour l’élection présidentielle de 2027.
La crise avait notamment démarré suite au soutien d’Emmanuel Macron à un plan d’autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Comment peut-on définir la politique française actuelle vis-à-vis du Maghreb et des enjeux qui s’y tiennent ?
Le Maghreb constitue une région stratégiquement importante pour la France, notamment dans un contexte de recul de l’influence française en Afrique, et les revers qu’elle a essuyés — notamment au Burkina Faso et au Mali — avec le retrait de ses effectifs militaires de ces différents territoires.
Dès lors, Paris entretient des relations très profondes et très étroites avec les pays du Maghreb, soit dans un cadre bilatéral, soit dans un cadre multilatéral, notamment via l’initiative 5+5 Défense, qui regroupe les cinq pays d’Afrique du Nord et les cinq pays européens méditerranéens.
Il existe aussi d’autres formats comme l’Union pour la Méditerranée, ou encore des formes de coopération plus larges entre les pays du Maghreb, l’Union européenne et l’OTAN. À noter que les pays du Maghreb sont en majorité partenaires non-membres de l’OTAN ayant le statut de membres observateurs.
Les pays du Maghreb jouent également un rôle de rempart face aux flux migratoires, à la fois issus de la migration maghrébine, mais aussi subsaharienne, qui ne cesse de croître compte tenu de l’instabilité régionale notamment au Sahel.
Il y a également un volet sécuritaire : la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, que ce soit au niveau du pourtour méditerranéen ou du Sahel. Tout cela nécessite bien évidemment une coopération étroite sur le plan sécuritaire avec les pays du Maghreb, que ce soit dans l’échange de renseignements ou via l’assistance technique.
Sur le plan économique également, le Maghreb constitue un marché important. Rappelons que des pays comme le Maroc ont renforcé leur coopération économique avec la France, et sont plus ouverts aux investissements étrangers — en témoigne la présence d’entreprises du CAC 40 sur le territoire marocain. L’Algérie, à son tour, a lancé de gigantesques projets dans les secteurs énergétique, de l’industrie agroalimentaire, infrastructurel… Globalement, le Maghreb présente donc des opportunités d’investissement dans différents secteurs.
On observe cependant un recul de la France en Algérie, longtemps premier fournisseur du pays, aujourd’hui devancée par la Chine, et plus récemment par l’Italie. Ce recul s’observe plus globalement sur l’ensemble des pays du Maghreb où les parts de marché françaises sont grignotées par une concurrence assez agressive — voire très active — venant notamment de la Chine, de la Russie, de l’Italie, mais aussi de la Turquie.
Sur le plan géostratégique, les pays du Maghreb sont aujourd’hui vus par la France comme un moyen de projection sur l’Afrique. L’idée est aussi de viser un redéploiement vers les pays d’Afrique de l’Ouest et le Sahel, en s’appuyant sur les liens très étroits que les pays du Maghreb ont tissés avec les pays de la région, notamment ceux de la CEDEAO de l’Afrique de l’Ouest.
Toutefois, la question du Sahara occidental a longtemps constitué une épine dans les relations intermaghrébines ou celles que les deux pays, Algérie et Maroc entretiennent avec leurs partenaires. Ce dossier torpille différentes initiatives régionales, Union du Maghreb Arabe (UMA), Union pour la Méditerranée, et impose beaucoup de prudence notamment aux partenaires européens, qui s’efforcent à ménager les deux géants du Maghreb : Alger et Rabat. La reconnaissance, en décembre 2020 de la marocanité du Sahara occidental, par Donald Trump, en contrepartie de la normalisation des relations avec Israël, a incité Rabat à durcir sa position vis-à-vis de ses partenaires, notamment européens. Ceci a conduit au revirement espagnol en 2022 après avoir subi une pression migratoire.
Le revirement français sur la question du Sahara occidental s’explique aussi par cela, sachant que l’opinion d’une bonne partie de la classe politique française est déjà favorable à la position marocaine. L’argument tient au fait qu’il y a à la fois des opportunités d’investissement que représente le Sahara occidental, mais également le fait que le Maroc a su développer une coopération très étroite avec les entreprises françaises, et s’affiche comme un hub économique à la fois pour le Maroc et pour le continent africain. Cela notamment grâce à son développement de coopération avec les pays de la CEDEAO. D’autre part, on observe chez les diplomates français un sentiment de lassitude et de frustration quant à l’absence d’ouverture de l’Algérie aux investissements français, où les autorités ont fait le choix de protectionnisme économique et d’ouverture à d’autres partenaires concurrents comme l’Italie, la Chine…
Comment analysez-vous la nature de la diplomatie algérienne et les déterminants de sa politique étrangère ?
Alger tente depuis quelques années de réaffirmer sa position régionale, après plus de deux décennies de recul et de repli diplomatique, dans un contexte marqué par l’escalade des tensions avec le voisin marocain, et l’instabilité régionale — notamment au Sahel ou en Libye — qui représentent des défis majeurs pour Alger.
D’autant que le contexte mondial très instable et incertain déstabilise le marché de l’énergie, lequel a été un levier d’influence important pour l’Algérie — bien que la flambé des cours énergétiques à l’issue de la guerre en Ukraine a été favorable à l’économie algérienneLe dossier du Sahara occidental et la rivalité historique avec le Maroc depuis l’indépendance, constitue un élément central de la diplomatie algérienne. Cela explique notamment sa réaction face au revirement de l’Espagne concernant la région, ainsi que, plus récemment, vis-à-vis de la France, avec le rappel de l’ambassadeur dans les deux cas. Si les relations avec Madrid ont été normalisées par le retour de l’ambassadeur algérien, ce n’est pas encore le cas avec Paris, où le poste d’ambassadeur reste vacant à ce jour, un chargé d’affaires assurant l’intérim.
Rappelons que l’Algérie soutient le Front Polisario et le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui depuis des années et que le pays accueille sur son sol environ 173 000 réfugiés sahraouis, dans des camps situés dans le Sud-ouest algérien. Tandis que le Maroc réclame la souveraineté sur ce territoire.
On observe ainsi depuis quelques années un durcissement de la diplomatie algérienne, lié à l’escalade des tensions avec ses voisins nourrissant un sentiment d’encerclement. On peut notamment citer l’instabilité chronique au Sahel, exacerbée par les tensions diplomatiques depuis le coup d’État au Mali, qui a porté Assimi Goïta au pouvoir. La junte a officiellement dénoncé l’Accord d’Alger, signé entre Bamako et les rebelles de l’Azawad en 2015, et a privilégié le rapport de force contre les rebelles touaregs. Cette posture renforce l’instabilité et l’inquiétude du côté algérien. Rappelons aussi que la question du Mali est une question de sécurité intérieure pour l’Algérie, les deux pays partageant environ 1400 kilomètres de frontière. La réaction du régime algérien sur l’affaire récente du drone malien de fabrication turque qui aurait pénétré le territoire algérien et abattu sur son sol, est symptomatique de l’inquiétude qui le gouverne et de l’intransigeance d’Alger vis-à-vis de toute source de menace à ses frontières. L’attaque terroriste sur le site gazier d’In Amenas en 2013 est un événement marquant pour l’armée algérienne.
Ajoutons également que derrière l’instabilité au Sahel, il y a l’arrivée de nouveaux acteurs, ou la montée en puissance d’acteurs étrangers comme la Russie, via le groupe Wagner, qui est maintenant remplacé en partie par Africa Corps, mais aussi d’autres acteurs comme la Turquie, les Émirats arabes unis, le Maroc… Tous cherchent à renforcer leur influence dans la région et sont perçus comme des menaces à la fois sécuritaires, économiques et stratégiques, constituant des entraves à des projets-clés pour son économie, notamment dans le secteur énergétique.
L’Algérie a relancé, par exemple, le projet de gazoduc transsaharien avec le Nigeria, via le Niger, pour acheminer le gaz vers l’Union européenne. Ces plans d’investissements constituent un axe important de sa stratégie de redéploiement régional et de projection à la fois vers l’Afrique et vers l’Europe. C’est aussi un moyen de renforcer sa rente gazière et ses revenus.
D’autres projets sont également menés par Sonatrach, la société pétrolière nationale algérienne, qui développe des partenariats avec plusieurs pays sahéliens. Parallèlement, on observe l’émergence d’acteurs industriels algériens que les autorités cherchent aujourd’hui à soutenir afin de favoriser l’établissement de partenariats économiques à l’échelle régionale.
Face à ce climat de tensions régionales, de rivalités géopolitiques et économiques, et de recompositions stratégiques, l’Algérie s’efforce de se repositionner en tant qu’acteur régional majeur, tout en protégeant ses frontières, ses intérêts et sa place sur la scène diplomatique. Alger devrait axer davantage ses efforts sur le dialogue au niveau local et régional et tenter de faire baisser les tensions avec son entourage dans le but de créer un terrain propice à la coopération et au développement de ses projets économiques localement et à l’extérieur.

