Notes / Observatoire du Maghreb
15 novembre 2022
Le Maghreb : un fort potentiel géostratégique et des perspectives de développement
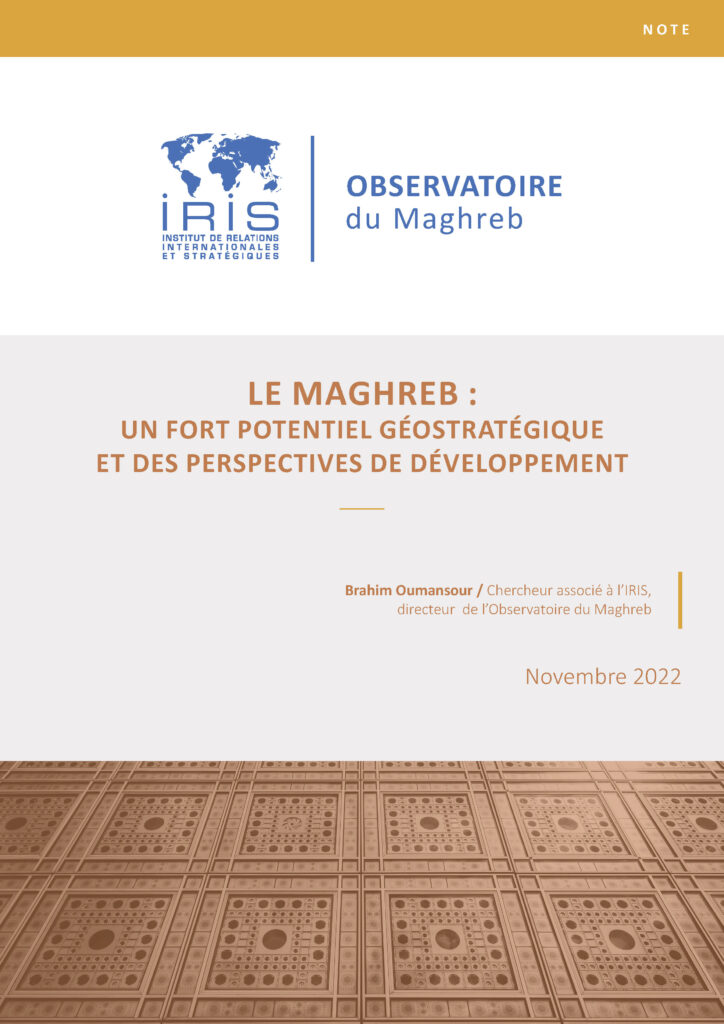
En 1989, les cinq pays du Maghreb, à savoir l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, fondaient l’Union du Maghreb arabe dans le but de promouvoir la coopération et l’intégration d’un marché commun. Toutefois, bien que l’intégration économique présente d’énormes avantages pour le développement de ces pays, ce projet est resté en suspens en raison notamment de tensions spécifiques et de la rivalité entre Alger et Rabat, parmi tant d’autres obstacles. Depuis leur indépendance, ces pays ont fait d’importants progrès comparés au reste du continent africain : une population de plus en plus éduquée dont l’espérance de vie passe d’environ 45 ans en moyenne à plus de 76 ans en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 72 ans en Libye et 65 ans en Mauritanie. Toutefois, quoique considérables, ces progrès restent insuffisants.
Les pays du Maghreb observent des dynamiques économiques et sociales différentes, mais ils partagent les mêmes défis avec, au premier rang, la fragilité économique et un taux de chômage très élevé, avoisinant les 30% en moyenne chez les jeunes. À cela s’ajoutent d’autres fléaux comme les tensions politiques et la corruption qui engendrent souvent des crises politiques internes. Pourtant, le Maghreb dispose d’un fort potentiel humain, géostratégique et économique qui lui donne des atouts indéniables. Zone sensible et stratégique, le Maghreb s’étend sur un territoire de plus de 6 millions de km² et compte environ 104 millions d’habitants. Situé au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et du Proche-Orient, son territoire regorge de ressources naturelles : pétrole, gaz, phosphates et autres richesses, qui lui donnent une importance géostratégique considérable et ouvrent la voie à des perspectives de développement et de coopération.
Le Maghreb est ainsi courtisé par les puissances mondiales et régionales : il constitue une porte vers l’Afrique ; sa proximité géographique avec l’Europe occidentale lui donne accès à l’un des trois principaux acteurs mondiaux du commerce international. D’autant plus qu’Alger et Rabat développent parallèlement deux projets de corridors routiers : l’axe Tanger/Nouakchott/Dakar et l’axe Tunis/Alger/Lagos, visant à relier l’Afrique subsaharienne aux ports maghrébins en Méditerranée. Dans l’absence d’un Maghreb unifié, les pays membres privilégient des relations bilatérales, en particulier avec les partenaires européens, la coopération européenne avec les pays du Maghreb s’étant construite dans la continuité des relations issues de l’indépendance des pays du Sud avec leurs anciens colonisateurs…

