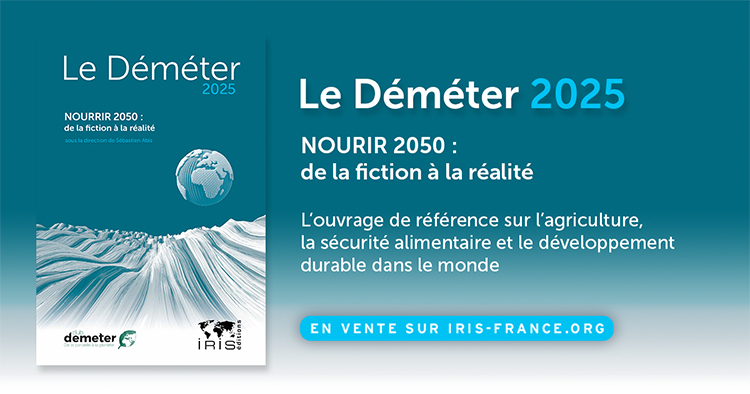Analyses / Énergie et matières premières
5 février 2025
Nourrir le futur à l’ombre des hippopotames
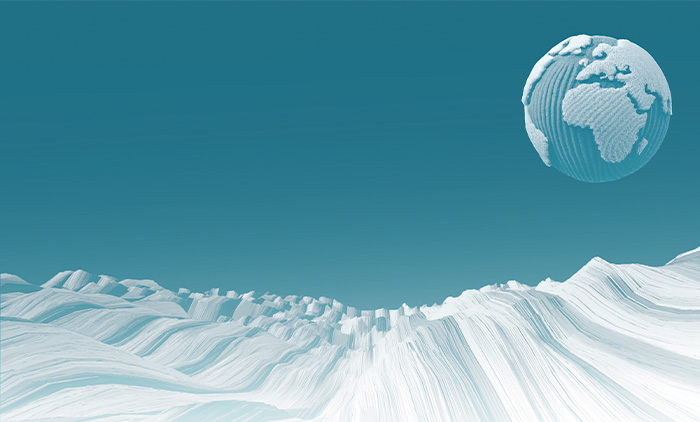
Cet article est extrait de l’ouvrage Le Déméter 2025 – Nourrir 2050 : de la fiction à la réalité (IRIS Éditions, 2025), sous la direction de Sébastien Abis.
Se souvenir du futur, c’est parfois savoir s’arrêter sur une année rotule : 2025 nous y invite assurément, bien que nous pourrions objecter que la visibilité sur l’avenir et ses variantes est actuellement bien réduite. Pour tenter de caractériser l’état du monde contemporain, sachons alors observer la dominance du moment en misant sur la force de concepts métaphoriques inédits afin d’en saisir les particularités. Nous ferons le pari de cet arrêt sur image pour mieux parcourir ensuite, à grandes enjambées, le fil cousu d’avance des prochaines années, car une constante stratégique nous y attend : nourrir.
Le temps géopolitique des hippopotames
Malgré les promesses d’un siècle moins excessif et les annonces de développement partout et pour toutes et tous, le bilan d’un premier quart effectué a largement de quoi rendre perplexe. La pacification intersociale et internationale ne parvient pas à gagner du terrain sur le globe, des inégalités de tout genre persistent ou tendent à se creuser de nouveau, les limites planétaires sont connues[1] mais la marche du monde, dans son ensemble, est telle que les dynamiques de freinage, dans leurs spécifi- cités, peinent à contrecarrer l’insoutenable. Nous devons poursuivre les efforts d’atténuation, mais définitivement nous placer dans une gestion de l’inévitable : l’adaptation. Si ces considérations valent pour le climat et les futures conditions de vie sur Terre, ne sous-estimons pas les ruptures géopolitiques en cours. Dans ce domaine, les changements, aussi, s’accélèrent. Et tout va plus vite, tout s’imbrique, tout se télescope, dans cette sphère ardente des relations internationales.
C’est l’ère des hippopotames, féroces, véloces, polygames. Après l’effet papillon des années 1990, où des événements pouvaient rejaillir dans d’autres pays ou d’autres secteurs au bout de quelques mois, d’au- tant que l’ouverture du monde était prônée avec son corolaire d’excédents narratifs comme l’illustra alors l’expression « village planétaire », le début du XXIe siècle fut marqué par l’hyperpuissance états-unienne et son hubris, mais aussi par la réémergence spectaculaire de la Chine. Pour celle-ci, dont l’appétit vivace ne fit plus de doute après la crise financière internationale de 2008, il s’agissait d’exprimer des ambitions de manière décomplexée, mais contrôlée. Une surveillance de Pékin pour ses dynamiques internes – prendre les commandes du monde, sans jamais oublier les clés du domicile –, mais également une vigilance intercontinentale face à la prise de conscience élargie de limites planétaires avérées – mise en place de l’Agenda onusien du développement durable. De quelle parabole la sino-mondialisation est-elle alors le nom ? D’un pachyderme dans un globe de porcelaine.
Cette ère géopolitique s’est estompée avec l’irruption du Covid-19, pandémie partie de Chine, claquemurant la majorité de la population terrestre en un battement de coups de fil. À l’issue de cette vaste émotion commune, aux réalités terriblement hétéroclites, le cillement géostratégique est brutal. Volatilité économique et paralysie politique, inflation du coût de la vie, choc de souverainetés, d’égoïsmes nationaux et d’aspirations désinhibées, guerres d’hier qui resurgissent, conflits qui persistent, s’intensifient ou qui germent, conditions climatiques qui s’emballent, désespoirs d’individus et violences humaines qui sapent la confiance, intelligences artificielles qui prospèrent au moment où le doute sur les bienfaits de la démocratie s’accentue et que des populismes entretiennent la tempête. La liste pourrait être plus longue encore de tous ces troubles qui donnent l’impression de naviguer dans un épais brouillard. En réalité, nous voilà au temps des hippopotames. Puisque le ciel est chargé et la brume consistante, faisons un détour par les plaines inondables et les marécages.
Si l’on s’en tient à l’étymologie grecque, nos « chevaux des rivières » paraissent bien paisibles. Placides dans leur immobilisme, contemplatifs par leurs regards fixes, ils présentent une allure davantage débonnaire que pugnace. Nous avons le plus souvent de l’affection pour ce mammifère semi-aquatique, en dépit de ses canines dont la longueur constitue des armes de dissuasion massive pour n’importe quelle chirurgie dentaire. Loin de nous l’idée ici d’avancer qu’il ne faudrait pas vouloir protéger la bête, le mal-être humain ne devant aucunement primer à côté du bien-être de l’animal. Comme il est mignon, l’hippopotame ! Et pourtant à craindre, aussi, car tellement agressif dès lors qu’un intrus le gène dans ses mouvements et que son territoire se retrouve violé. L’hippopotame, dont le poids se mesure en tonnes et dont la taille s’établit en mètres, frappe certes par ses mensurations généreuses, mais surtout par sa grande imprévisibilité. Il est d’une terrible férocité – s’il cause moins de décès humains que l’abominable moustique ou même le soi-disant gentil chien, notre cheval d’eau n’en reste pas moins un prédateur de premier plan –, il peut se déplacer très rapidement – avec des pointes dignes d’un athlète de haut niveau, n’en déplaise à la gravité – et dispose d’atouts précieux pour se défendre ou attaquer – souffle remarquable ; peau pro- tectrice des agressions extérieures, qu’elles soient solaires, d’insectes et de ravageurs ; facilité à tenir en apnée longue sous l’eau ; anatomie d’un sous-marin avec des yeux, un nez et des oreilles opérant tel un périscope discret à la surface pour observer les alentours pendant que l’essentiel de sa peau lisse et sombre reste immergé, etc. N’allons pas plus loin dans la description de ce colosse dont la sympathie est sans doute plus imaginaire que réelle. Ajoutons tout de même une dernière pièce essentielle à notre puzzle zoopolitique : l’hippopotame est polygame. Le mâle, supérieur et phallocratique, se plaît à vivre avec un groupe composé de deux à trois… dizaines de femelles. Pour s’accoupler, il n’est pas rare que deux mâles se livrent bataille, dans un duel parfois mortel. Surprenant mammifère, plein de contrastes : les êtres humains le braconnent ou sont attendris par sa corpulence ; son flegme dans l’eau assoupit sa sauvagerie potentielle, il sort sans hésiter ses crocs à la moindre escarmouche et ne refuse pas la viande bien qu’il soit avant tout herbivore.
Revenons à la géopolitique et à cet état du monde dont nous confessions la nervosité et la brutalité. Quelle correspondance actuelle avec ces hippopotames féroces, véloces et polygames ? Durcissement, accélération et multi-alignement se combinent dans le comportement d’acteurs dominants ou qui cherchent à l’être en exploitant pour cela un large spectre d’outils et de moyens. Les relations internationales et intersociales se tendent. La loi du plus fort retrouve de la voix. L’esprit de revanche gagne des consciences et les coalitions qui progressent sont celles associant les ressentiments, ce qui n’a jamais été de bon augure[2]. Le respect des règles n’est plus l’unique voie. Des radicalités se déchaînent là où des libertés se perdent. La défense d’intérêts particuliers l’emporte sur le vivre-ensemble. Les adjectifs qualifiant les rapports des uns avec les autres versent dans la méfiance : précautionnistes, protectionnistes, transactionnels. Tout est tarifé. Rien de vraiment nouveau[3], si ce n’est que les offensives économiques s’aiguisent, se diversifient et se fortifient. Les États n’ont pas le monopole de ce penchant du moment. Les grandes entreprises du numérique ont acquis tellement de puissance par leur présence multicanale qu’elles sont devenues des acteurs déterminants de la scène géopolitique actuelle et en devenir[4]. Il serait tentant, en ce début 2025, de penser à Elon Trump pour donner une illustration immédiate de ce trait de caractère imprédictible, parfois injurieux, parfois disruptif, qui gagne la grammaire des relations humaines ou internationales.
Celles-ci vont toujours plus vite. Plus le temps passe, plus l’on nous propose des solutions pour en gagner, mais nous en cherchons sans cesse davantage en ayant l’impression de courir après lui. Serions-nous dépassés par l’accélération du monde et de ses transformations structurelles ? La hiérarchie des pouvoirs évolue parfois plus vite que prévu, des vulnérabilités se dévoilent par ici et des forces se révèlent par ail- leurs[5], la fragilité de la vie persiste mais d’aucuns songent au transhumanisme pour tuer la mort. Simultanément, la géographie et le climat, censés être nos boussoles, nous déconcertent. Alors, on se tance sur un volcan. Pour sauver la planète, des ajustements sévères sont nécessaires dès maintenant pour conduire des transitions inéluctables si l’on vise de la soutenabilité à long terme. Or, à l’heure de cette transition verte, vive la sobriété ou revoici les rivalités ? Le risque est grand que celle-ci soit perçue comme une affaire de riches ; pire, qu’elle soit sup- portable uniquement par une minorité de privilégiés ou instaurée par autorité. N’allons pas croire à l’unique nouvelle lutte des classes. La géo- ingénierie laisse transpirer de futurs affrontements. Voler les nuages de son voisin pour s’assurer qu’il pleuve sur son territoire afin de le rendre fertile ne sera pas une technologie à la portée de tous, outre le fait que ce technosolutionnisme ne sera pas sans conséquence sur les équilibres climatiques globaux. La cartographie des nations qui s’empressent dans ce registre ne doit pas laisser indifférent[6]. Il s’agit d’un exemple parmi d’autres d’un monde de fragmentations nouvelles, issues de pouvoirs inégalitaires tirés par la maîtrise d’instruments scientifiques aux origines souvent militaires. Tant d’enjeux géopolitiques contemporains présentent des soubassements de ce registre : ainsi de la course de moins en moins silencieuse aux microprocesseurs, déroulant les manœuvres de plusieurs puissances et les frictions belliqueuses qu’elles induisent[7].
Férocité, vélocité, mais aussi polygamie, avions-nous dit à propos de nos redoutables hippos. Il en est de même dans les relations inter- nationales, où il est de bon ton de parler de multi-alignement afin de caractériser le comportement de nations qui font passer leurs besoins essentiels avant toute autre considération et qui n’hésitent aucunement à afficher leurs pratiques stratégiques par des politiques extérieures multidirectionnelles. Peu importe le nombre de partenaires, le fait que ces derniers puissent être tour à tour complices ou adversaires : il s’agit de pragmatisme avant tout et au fil de l’eau. Ainsi donc progressent la diversification des relations et l’hétérogénéité de celles-ci : circonstancielles, conjoncturelles, performatives, passagères, recyclables, jetables, ou encore méthodiques, tactiques et rusées. L’objectif n’est pas de plaire ou de faire dans la durée ; la relation correspond davantage à un but à atteindre, et si possible, rapidement. Les logiques de blocs volent en éclats. Les alliances sont appelées à être éphémères. L’infidélité n’est plus cachée, elle est désormais assumée. Des affinités peuvent exister, elles n’en sont pas moins précaires. Dans l’ère des hippopotames, emprunte d’instabilités et de duretés, il faut savoir être à la fois fort, agile et résilient, mais aussi intuitif, engagé et détaché. Dit autrement, maîtriser son destin, et donc dé-risquer toutes les relations.
Pour l’Europe, faire l’autruche, s’associer davantage ou disparaître
Afin d’interroger la place de l’Europe dans cette séquence déstabilisatrice, nous serions tentés d’avancer l’idée d’une « multhippopolarité » : soit la capacité ou non des acteurs – étatiques ou privés – à être cohérents entre soutien policé au multilatéralisme – coopération – et reconnaissance d’une multipolarité effective – compétition – pour savoir gérer les tensions ou opérer en cas de conflits – confrontation. En miroir, cela signifie de pouvoir mettre en œuvre une « hippoplomatie » : soit le développement d’un narratif approprié, entre valeurs et intérêts à défendre, à peser sur les affaires stratégiques du moment et en devenir, à savoir tisser des relations éclectiques sans en être le conducteur unique, tout en sachant pertinemment que plus personne ne respectera formellement ses engagements. Disons même qu’en combinant multihippopolarité et hippoplomatie, la planète risque de tomber dans une « hippopothermie » inversée : un réchauffement rapide et brutal de la vaste plaine géopolitique. La planète voit sa fièvre grimper dangereusement. Rappelons une certitude : s’il n’existe pas de planète B où aller en cas d’emballement climatique insoutenable sur Terre, il n’y a pas non plus de planète B en cas de surchauffe humaine, sociale et internationale insupportable. C’est toute la difficulté de l’équation de ce siècle : pour investir dans le vert, il est impossible d’être dans le rouge. Formulons dès lors une hypo(po)thèse : l’Union européenne (UE) devrait-elle impassiblement faire fi de ces recompositions profondes qui parsèment le globe et se mettre la tête dans le sable, comme une autruche ? Pourrait-elle, au contraire, graduellement gagner en robustesse, retrouver de la souplesse et s’adapter à cette nouvelle donne[8] ? Ou faudrait-il qu’elle réduise vivement son allure, dans ce carrefour temporel où certains seraient même prêts à revenir en arrière ?
Dans ce maelström de changements stratégiques, nos démocraties européennes sont indéniablement bousculées. Elles n’ont pas, ou n’ont plus, l’habitude de devoir composer avec de l’imprévisibilité, de l’agressivité et de la rapidité. Certains de leurs atouts – comme le faire et le vivre-ensemble – se font cogner par la chute du compromis[9], la désinformation partisane et l’écume émotive du jour présent. L’Europe entend le bruit des armes à ses portes et redécouvre l’ombre de la guerre, non sans tergiverser entre valeurs à promouvoir et intérêts à protéger[10]. Dans ce contexte, le moindre choc est mal amorti. Nos démocraties, frileuses avec la prise de risques, peinent à proposer des repères d’avenir, alors que de nombreux individus dans le monde, notamment désertique, y verront encore longtemps un continent vers lequel se diriger. Mais là aussi, les mouvements sont multipolarisés. L’Afrique du Sud accueille autant de migrants africains que l’ensemble des pays de l’UE. L’Inde voit sa démographie croître également en raison de déplacements de populations limitrophes confrontées aux insécurités en tout genre. Ainsi va la planète, les mobilités y sont incessantes, mais nous n’avons jamais eu autant de murs, physiques et immatériels, sans doute parce que l’accent porte sur les problèmes, rarement sur les causes. Diktat du court terme, quand tu nous emportes.
L’Europe s’interroge : a-t-elle encore une place dans ce marécage turbulent ? Comment nourrir sa trajectoire à 2050 ? Faut-il mettre fin à ce Pacte vert qui était supposé être le grand dessein ? Peut-on réussir à développer une compétitivité durable sans renforcer l’intégration géopolitique, ou du moins l’autonomie stratégique, dont nous pour- rions supputer qu’elle advienne si et seulement si les États membres de l’UE jouaient encore plus collectif demain. L’Europe est puissante dans l’agrégation de ses statistiques, mais bien souvent impuissante dans l’expression de ses métriques. Exemple avec sa réindustrialisation, prônée depuis le début de cette décennie, qui reste balbutiante et pourrait surtout se faire aux États-Unis, terrain de jeu plus favorable et plus agile, là où notre Europe, aux sociétés vieillissantes et désenchantées, demeure naïve, ankylosée et apathique. Tel un hippopotame fatigué, démotivé et sous anesthésie, autrefois dominant, ou ayant eu l’impression de l’être[11], ce qui n’arrangera en rien son sort vraisemblable au menu du monde. Avant cela, si vogue la galère, l’Europe pourrait être sapée par une désynchronisation de son propre agenda avec celui des autres puissances de ce monde, surtout si ses – modestes – ambitions pêchent par manque de moyens, par l’incohérence de ses politiques, par l’emballement réglementaire qui parfois séquestre les énergies, et par cette myopie stratégique consistant à penser que le meilleur moyen de reprendre le contrôle serait d’affaiblir l’union des États européens. Ensemble pour aller loin, mais seul pour aller vite : la marche géopolitique à la mode, c’est le rallye en solitaire, pas la vision collective pour l’avenir. Le drame de l’Europe, ce n’est pas de ne pas être féroce avec les autres. C’est de potentiellement redevenir agressive avec elle-même, d’en oublier le sursaut sociétal et politique de la seconde moitié du XXe siècle et de se précipiter, avec vélocité, dans les pires périodes de son histoire. Si nos démocraties et nos synergies vacillent, nos systèmes agricoles et alimentaires solides et solidaires, à l’européenne, voleront en éclats. Peut-être ce mouvement a-t-il déjà commencé, bien mal nommé, ce qui ajoute inévitablement au malheur de tout ce monde. C’est ici que nous devons transiter vers l’inévitable.
Nourrir ne peut attendre
L’inévitable, c’est de devoir se nourrir. L’ingérable, c’est de savoir si toutes et tous le peuvent et le pourront. L’inévitable vital d’un côté, l’indélicate question du moment de l’autre : allons-nous produire, non pas plus mais autant demain, avec stabilité ou hypervolatilité ? Tel est le paradoxe : un besoin invariable et universel se heurte à de potentiels murs techniques, climatiques et géopolitiques. D’où l’irruption, à l’ère des hippopotames, de visées territoriales nouvelles, de frontières à redéfinir ou à conquérir, d’un comportement transcendant les us et coutumes de relations inter- nationales établies ces dernières décennies, à commencer par le droit dont le sol est bafoué allégrement, par certains ou par troupeaux. Résultat, si la faim reste le premier des malheurs que chacun ne peut et ne veut vivre, nous observons deux grands plats sur cette table mondiale : l’ardeur de l’histoire et la revanche de la géographie.
En 2025, bien malin celui qui serait à même de prédire dans quelle direction le monde se dirige. Imprévisibilité et illisibilité stratégiques tendent à se combiner au point d’assombrir nos capacités à regarder au-delà de la ligne d’horizon. D’ailleurs, à quelle distance se situe-t-elle, désormais, cette apparente perspective, censée jouer un rôle crucial dans notre orientation spatio-temporelle ? Alors qu’elle devrait évoquer des aspirations lointaines et des buts à atteindre, serait-elle devenue symbole d’avenir incertain et de limites à respecter ? Quelle profondeur de champ pouvons-nous établir dans cette époque où l’anxiété domine les pensées et les paroles ? Sommes-nous capables de nous projeter à 2050, une date équidistante de cet an 2000, qui pour beaucoup semble si proche, là où le milieu de ce siècle nous échappe si souvent. Allons-y tout de go : l’accélération des transformations dans tous les domaines tendrait-elle à rendre la prospective aveugle ? Ajoutée à l’affolement sociétal provoqué par l’urgence du quotidien, nous pourrions aborder cette année de césure temporelle comme des naufragés d’une vague submersive dont la pandémie de Covid-19 aura été un puissant catalyseur. Ou alors, nous pouvons aussi contrer cette tyrannie court-termiste, qui fréquemment se conjugue avec des réflexes à courte portée géographique. Pour voir loin, il faut certes garder les pieds sur Terre, et donc assurément s’occuper du lendemain et de la proximité. Pour autant, devons-nous renoncer aux futurs et aux grands larges, à être architectes de trajectoires souhaitées et non subies, à comprendre que la complexité du monde contemporain et à venir nous impose une mixité d’expériences et de réflexions pour avancer ? En somme, une avalanche vitale d’interdépendances à cultiver. Mais la dominance des relations internationales et intersociales actuelles est ailleurs. Durcir, forcer et rivaliser. Exagérer, invectiver et se moquer. Pour une Europe soucieuse de dialogue et de coopération, qui s’est trop longtemps crue à l’abri des violences et considérée, avec un excès fatidique, comme inspirante pour l’humanité, la bascule à l’œuvre est violente. Quand tout semble vaciller, il faut s’accrocher aux invariants. Quand rien ne paraît clair à l’horizon, il convient de rester fermes sur des convictions. Les questions agricoles et alimentaires recoupent ces préconisations. Et ce qui vaut pour l’étroite presqu’île européenne est vrai pour l’archipel mondial. Pour nourrir 2050, les fondamentaux ne sauraient être oubliés. La population va poursuivre son ascension et atteindre, selon les Nations unies, 9,7 milliards d’habitants, soit près de 20 % de personnes supplémentaires par rapport à 2025. D’ici au milieu de ce siècle, les comportements alimentaires évolueront, comme depuis toujours, mais avec une dose accrue d’innovations médicales et techniques, pour le meilleur comme pour aussi peut-être le pire. Certains auront tendance à manger moins, d’autres expérimenteront les coupe-faims, des solutions nutritionnelles sur mesure seront mises sur les marchés, des pro- duits seront boycottés ou primés, les régimes et les modes alimentaires demeureront tributaires de croyances de tout type, la praticité et le prix guideront encore longtemps les achats et les consommations, etc. Deux risques, en apparence très distincts, à surveiller d’ici 2050 : le premier autour d’un clivage grandissant entre ceux dont la réflexion et l’action portent sur l’alimentation pour chacun et ceux qui pensent et agissent pour l’alimentation de toutes et tous ; le second sur la persistance de famines chroniques ou temporaires dans le prochain quart de ce siècle, avec la conséquence à long terme d’une sous-nutrition des plus jeunes qui réduit l’intelligence. Terribles oublis commis parfois : ventres affamés n’ont jamais eu d’oreilles et rien n’indique que cela pourrait changer demain, un enfant en carences alimentaires sévères et continues verra inéluctablement son quotient intellectuel limité pour le restant de sa vie[12]. Faim et pauvreté nutritionnelle fabriquent désordres et faiblesses durables.
Nourrir 2050 sans sécurité alimentaire n’est que pure ineptie. Et sans agriculteurs, aquaculteurs ou pêcheurs, à mauvais entendeur, salut ! Et sans science, sans industries, sans entreprises, sans logistique dans cet immense secteur, pas de durabilité dans les chaînes de valeur. Peut-on sérieusement cheminer vers 2050 en mettant les questions alimentaires de côté et ne pas voir ô combien l’agriculture est appelée à jouer un rôle inédit[13] ? Il ne s’agit pas là du seul sujet ou de l’unique priorité, mais il s’agit d’un invariant et d’une conviction. Il en va d’enjeux géopolitiques et environnementaux, par tous les continents, avec des conditions d’exercice cependant transformées. C’est là où sur les défis alimentaires, les fictions ne doivent pas omettre la ténacité de réalités agricoles[14] : ressources hydriques ou foncières rares et convoitées, énergies disputées et à décarboner, climats instables et parfois violents, risques sanitaires décuplés, etc. La science et l’agronomie sont appelées à la rescousse. L’océan est attendu comme messie pour dessaler de l’eau, la première de toutes les boissons, mais encore aussi pour fournir du poisson, surtout dans les mers des pôles où la fonte des glaces libère des espaces. La biomasse est invitée à ravitailler l’écologie circulaire, faisant donc un appel à davantage d’énergiculteurs. La logistique sera plus cruciale encore pour déplacer, ne rien perdre et approvisionner ; certaines routes – terrestres, maritimes, spatiales, sous-marines – gagneront en importance. Ne sous-estimons pas la métaphore de l’hippopotame : ils sont nombreux à s’activer pour produire ou trouver de la nourriture, non sans provoquer sur leur chemin de périlleux duels. Faut-il alors s’attendre demain, au niveau local comme peut-être régional, voire mondial, à des combats ali-militaires ? Après tout, la planète dépense actuellement 2 500 milliards de dollars par an pour s’armer. Quelle part de cette somme sert à la sécurité alimentaire de chacun ? Sans doute bien plus que les montants dédiés directement au développement d’agricultures productives, durables et saines. Tragique illustration d’un monde combattif, non pour aller collectivement de l’avant, mais pour s’en sortir séparément.
Férocité, vélocité, polygamie. Devant de tels appétits stratégiques, où nous mènerait la frugalité de pensées ? À l’ombre des hippopotames, des forces géopolitiques, économiques et sociales sont à l’œuvre pour renverser des pouvoirs et alimenter leur ambition à 2050. Qu’on se le dise, ces déterminations, ces investissements et ces choix prioritaires que certains sont en train de faire affecteront de manière puissante la sécurité alimentaire mondiale. Pour l’Europe, se souvenir du futur, c’est savoir dès maintenant agir pour 2050 et s’y préparer avec l’équipement nécessaire et l’intelligence de baliser son propre chemin sans pour autant se fermer au monde qui l’entoure, car il pourrait surtout lui serrer fermement la ceinture. En conséquence, bien prendre conscience d’un danger et d’une obligation. Le danger de ne plus se projeter et surtout de ne plus savoir avancer vers une ligne d’horizon lointaine et qui sera différente. L’immédiateté sera sinon la carie de notre lucidité. L’obligation de ne jamais déclasser ce qui fonde notre sécurité à toutes et tous : l’alimentation. Aujourd’hui comme demain, en 2025 ou en 2050, nourrir ne peut attendre.
[1] Sandrine Dixson-Declève et al., Earth for All/Terre pour tous. Nouveau rapport au Club de Rome (Arles : Actes Sud, 2023).
[2] Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations (Paris : Grasset, 2019).
[3] Ali Laïdi, Histoire mondiale du protectionnisme (Paris : Passés composés, 2022).
[4] Kai-Fu Lee, AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order (Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2018).
[5] Thomas Gomart, L’accélération de l’histoire. Les nœuds géostratégiques d’un monde hors de contrôle (Paris : Tallandier, 2024).
[6] Marine de Guglielmo Weber et Rémi Noyon, Le grand retournement. Comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques (Paris : Les Liens qui Libèrent, 2024).
[7] Chris Miller, Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology (New York : Simon & Schuster, 2022).
[8] Enrico Letta, Faire l’Europe dans un monde de brutes (Paris : Fayard, 2017).
[9] Laurent Berger et Jean Viard, Pour une société du compromis (La Tour-d’Aigues : L’Aube, 2024).
[10] Pascal Boniface, Guerre en Ukraine, l’onde de choc géopolitique (Paris : Eyrolles, 2023).
[11] Sébastien Abis, « Europe, globally alone », dans Sébastien Abis (dir.), Le Déméter 2024. Mondes agricoles : cultiver la paix en temps de guerre (Paris : Club DEMETER – IRIS Éditions) : 15-22.
[12] « How to raise the world’s IQ », The Economist, 13 juillet 2024.
[13] Voir Vincent Chatelier, Martin Pidoux, Thierry Pouch et Marine Raffray (dir.), Politiques agricoles. Théories, histoires, réformes et expériences (Paris : Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de l’économiste », 2025 [à paraître]) ; Philippe Ducroquet et Jean-Paul Charvet, Atlas de l’alimentation et des politiques agricoles. Com- ment nourrir la planète en 2050 ? (Paris : Éditions du Rocher, 2024) ; Julien Denormandie et Erik Orsenna, Nourrir sans dévaster. Petit précis de mondialisation – VII (Paris : Flammarion, 2024) ; et Sébastien Abis, Veut-on nourrir le monde ? Franchir l’Everest alimentaire en 2050 (Paris : Armand Colin, 2024).
[14] Liam Fox, The Coming Storm. Why Water Will Write the 21st Century (Hull : Biteback Publishing, 2024).