Humanitaire et développement
Juin 2024
Introduction. L’aide internationale, instrument d’émancipation ou de contrôle ?
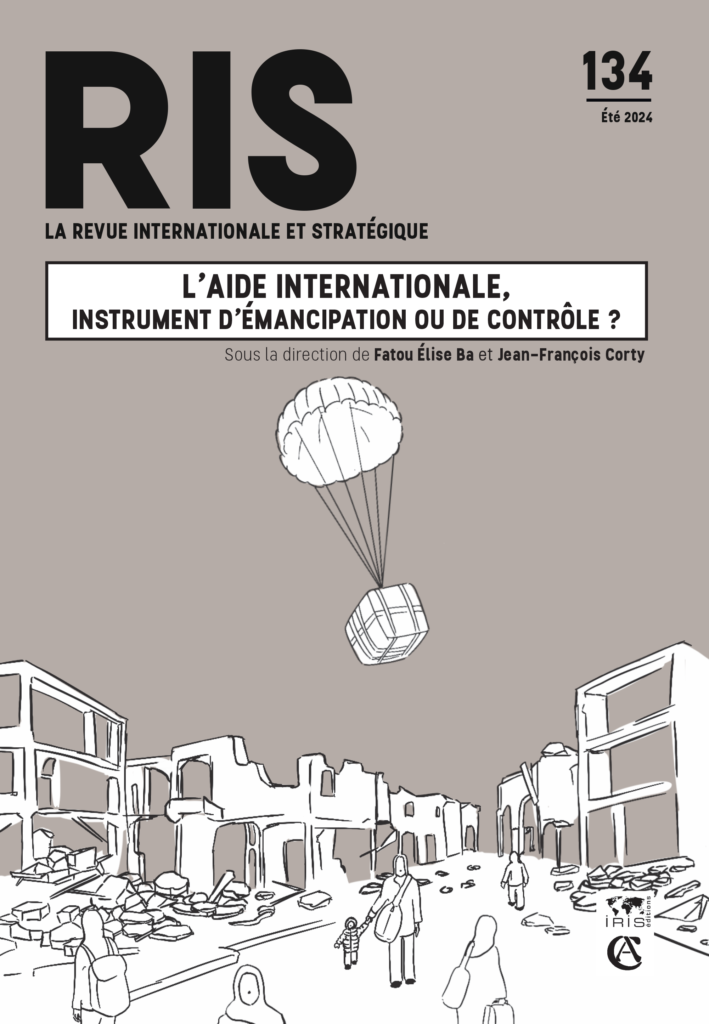 L’aide internationale, instrument d’émancipation ou de contrôle ?
L’aide internationale, instrument d’émancipation ou de contrôle ?
RIS 134 - Été 2024
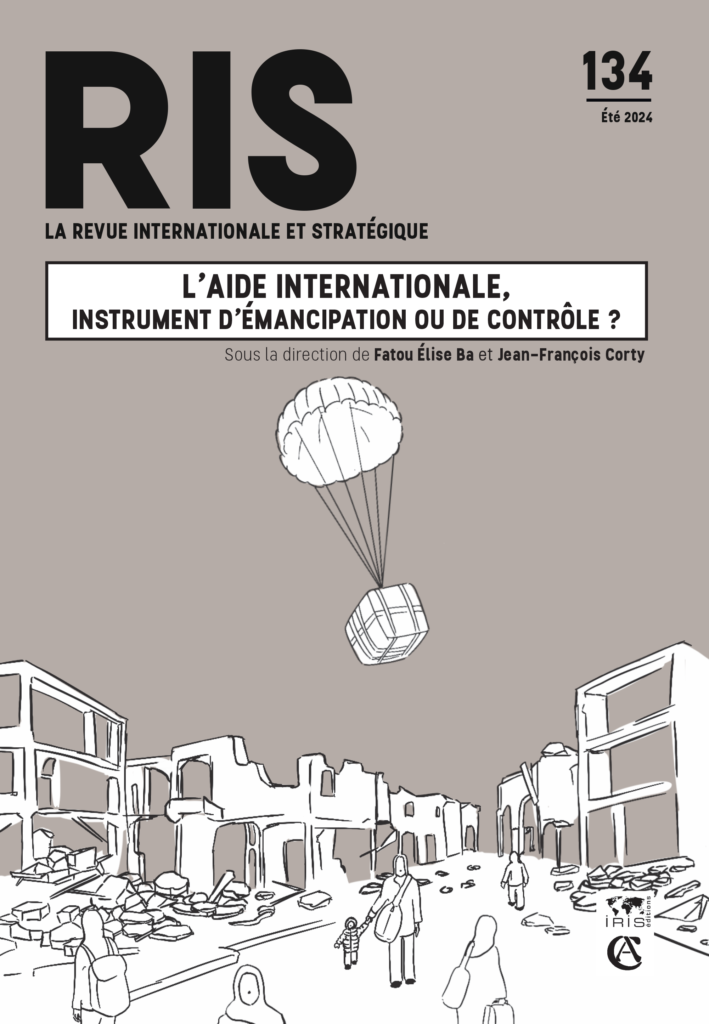
Si les guerres en Ukraine et à Gaza occupent la plus grande partie de l’espace médiatique, d’autres crises majeures sont passées sous silence et de nombreuses zones sont toujours en quête de stabilité, souffrant de pauvreté chronique, d’insécurité alimentaire, de violence banalisée envers les civils et de corruption plus ou moins généralisée. Pourtant, jamais autant de ressources humaines et financières n’ont été déployées par les États, organisations internationales et acteurs non étatiques pour répondre aux besoins des plus vulnérables [1]. Visant à répondre aux crises humanitaires et à promouvoir le développement, le secteur de l’aide internationale implique une multitude d’acteurs aux enjeux et intérêts divers. Traditionnellement dominé par les États du « Nord » et les grandes organisations internationales, il est marqué par l’émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux intérêts et par la persistance de questions et




