Notes / Sécurité humaine
29 septembre 2016
Les camps dans les crises humanitaires : l’envers du décor
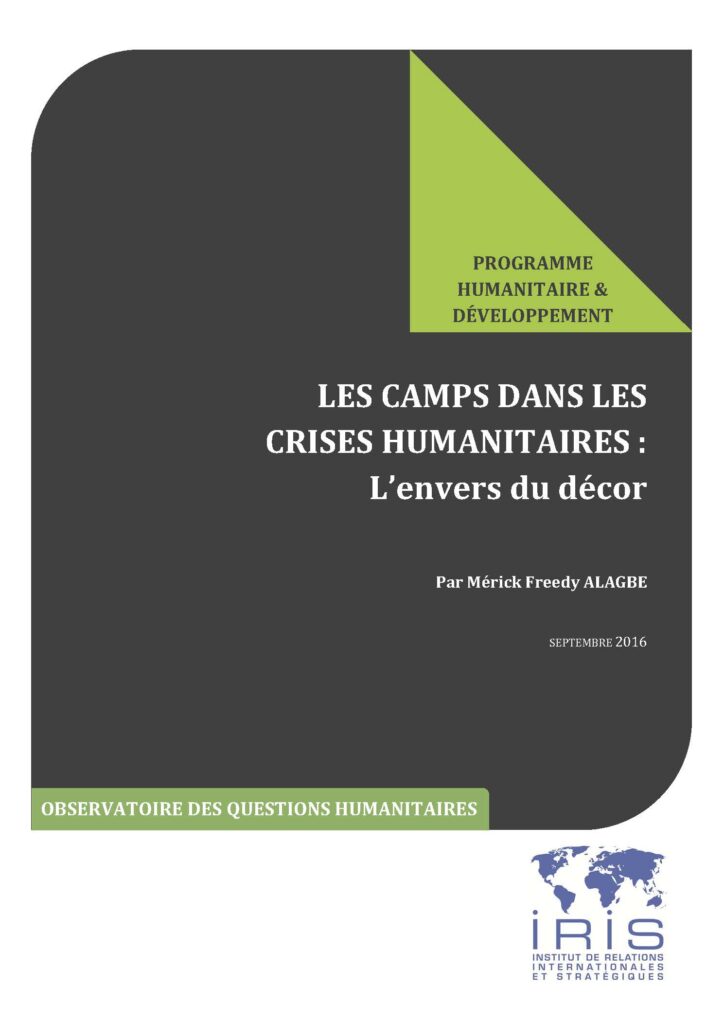
Les grandes crises humanitaires contemporaines nous ont habitués aux déplacements massifs de populations et à la constitution spontanée ou organisée de camps d’accueil. On se souvient des camps disséminés dans le sud de la France (Argelès-sur-Mer ; Saint-Cyprien ; Rivesaltes ; Barcarès, etc.), qui ont accueilli en 1939 les réfugiés espagnols victimes du franquisme ; des camps en Autriche et dans la Yougoslavie de Tito, qui ont accueilli les réfugiés hongrois fuyant la répression après la révolution de 1956 ; des camps éparpillés en Thaïlande, Indonésie, Malaisie et aux Philippines qui ont hébergé les réfugiés vietnamiens à la fin des années 1970 ; ou ceux encore d’actualité à Dadaab dans le nord du Kenya, ou dans la région de Goz Beïda au Tchad, etc. Même si, historiquement, il est difficile de situer avec précision l’apparition des premières formes de camps d’internement, ne convient-il pas tout de même de s’interroger sur les vraies raisons de leur existence ? Il est de notoriété que dans l’histoire tumultueuse de l’humanité, ils ont servi des desseins variés, parfois contradictoires et très éloignés de l’objectif purement humanitaire. Les travaux de Denis Peschanski révèlent par exemple qu’en moins d’une décennie (entre 1938 et 1946) des logiques très contrastées ont justifié en France la construction des camps. Aussi, la pluralité des acteurs ajoute-t-elle au conflit des objectifs. En effet, un décryptage du processus d’installation des camps et de leur administration dans la durée révèle par exemple de profondes divergences de vues entre les acteurs politique et humanitaire. À la recherche obsédante de l’efficacité opérationnelle des humanitaires, s’opposent souvent les calculs politiques cyniques des autorités gouvernementales.

