Notes / Sécurité humaine
16 mars 2016
Implication croissante du secteur privé dans le système de réponse humanitaire : risques et opportunités
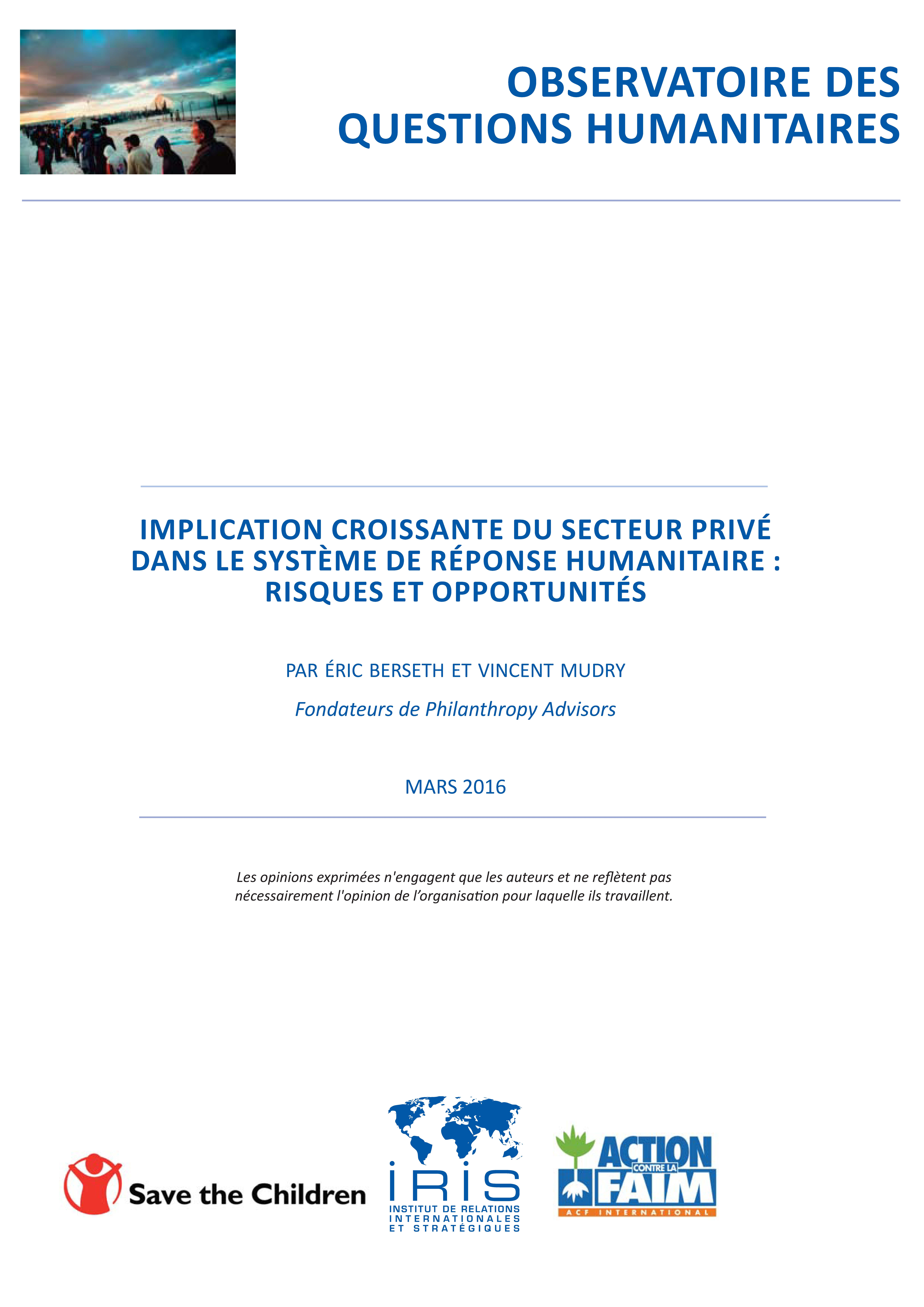
Il n’est un secret pour personne que le secteur privé et le système de réponse humanitaire, que ce soient les agences des Nations unies, les ONG ou le mouvement Croix Rouge, sont passés depuis déjà des années de la défiance à la construction de partenariats effectifs, redessinant les contours comme les enjeux d’un secteur en pleine mutation. Le « secteur privé » est un terme vaste recouvrant différents acteurs – petits donateurs individuels, individus fortunés, fondations, entreprises – contribuant de différentes manières et pour différentes raisons aux réponses humanitaires. La multiplicité des approches et des logiques d’intervention n’en font pas une entité homogène mais contient pourtant une sorte de cohérence dans le rôle qu’il prend ou qu’il prétend avoir dans la responsabilité collective face à la nécessité de réponse aux drames humanitaires. L’arrivée de nouveaux acteurs dans un secteur où les rôles de chacun étaient auparavant bien définis, redessine la place et la fonction impartie et revendiquée des différentes parties prenantes.
Cette implication croissante, mesurée par les chiffres de la contribution globale au secteur, passée de 17% à 32% entre 2006 et 2010, est principalement financière (5,8 milliard de dons privés en 2014). Néanmoins, elle prend aussi de nombreuses autres formes tels les dons en nature, la mise à disposition de main d’œuvre ou le transfert de savoirs, compétences ou technologies, ou encore la mise à disposition à des tarifs préférentiels de produits ou services spécifiques développés dans le cadre de partenariats…

