Notes / Sécurité humaine
10 septembre 2015
Histoire et enjeux de l’aide internationale des Émirats arabes unis : une stratégie de bailleur fédérale, entre pluralité et unité
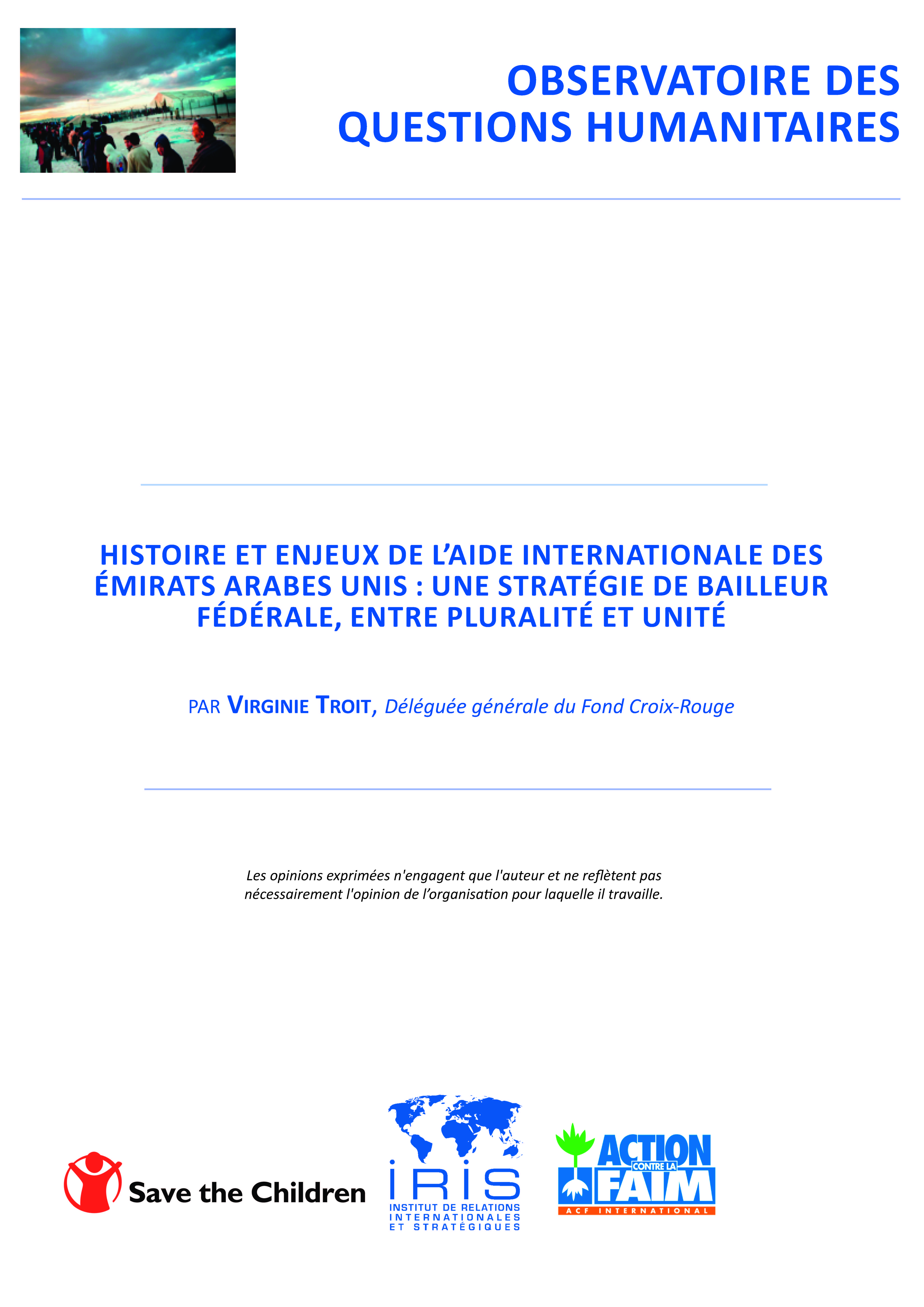
Les pays donateurs du Golfe comptent parmi les pays les plus généreux au monde entre 1973 et 2008. Le dialogue autour des enjeux de l’aide internationale s’ouvre progressivement aux pays non-membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, que ce soit dans les analyses statistiques ou lors des forums mondiaux. Pourtant, l’aide publique au développement (APD) et l’aide humanitaire provenant des pays du Golfe, et plus particulièrement des Emirats arabes unis (E.A.U.), sont peu connues. Entre les années 1960 et 1970, Abu Dhabi passe du statut d’un village de 3.000 habitants vivant dans la plus grande pauvreté sous protectorat britannique, à celui de capitale d’une fédération indépendante (1971) et exportatrice de pétrole. Sous l’initiative de Cheikh Zayed, les E.A.U. lancent dès leur indépendance, et malgré des besoins intérieurs immenses, une politique d’aide au développement d’ampleur ciblant dans un premier temps les pays arabes. Comment la jeune fédération a-t-elle procédé ? Comment l’aide s’est-elle institutionnalisée – à Abu Dhabi, Dubaï et les 5 autres émirats – et avec quelles motivations au cours de décennies ? La création de l’Office for the Coordination of Foreign Aid (OCFA) en 2008 montre une volonté forte d’Abu Dhabi, de faire le point sur les initiatives de solidarité de chaque émirat et de coordonner les stratégies de d’aide afin de positionner les E.A.U comme « membre clef de la communauté humanitaire internationale ».[5]

