Notes / Observatoire géopolitique du religieux
25 février 2015
L’urgence des réponses au financement du radicalisme religieux
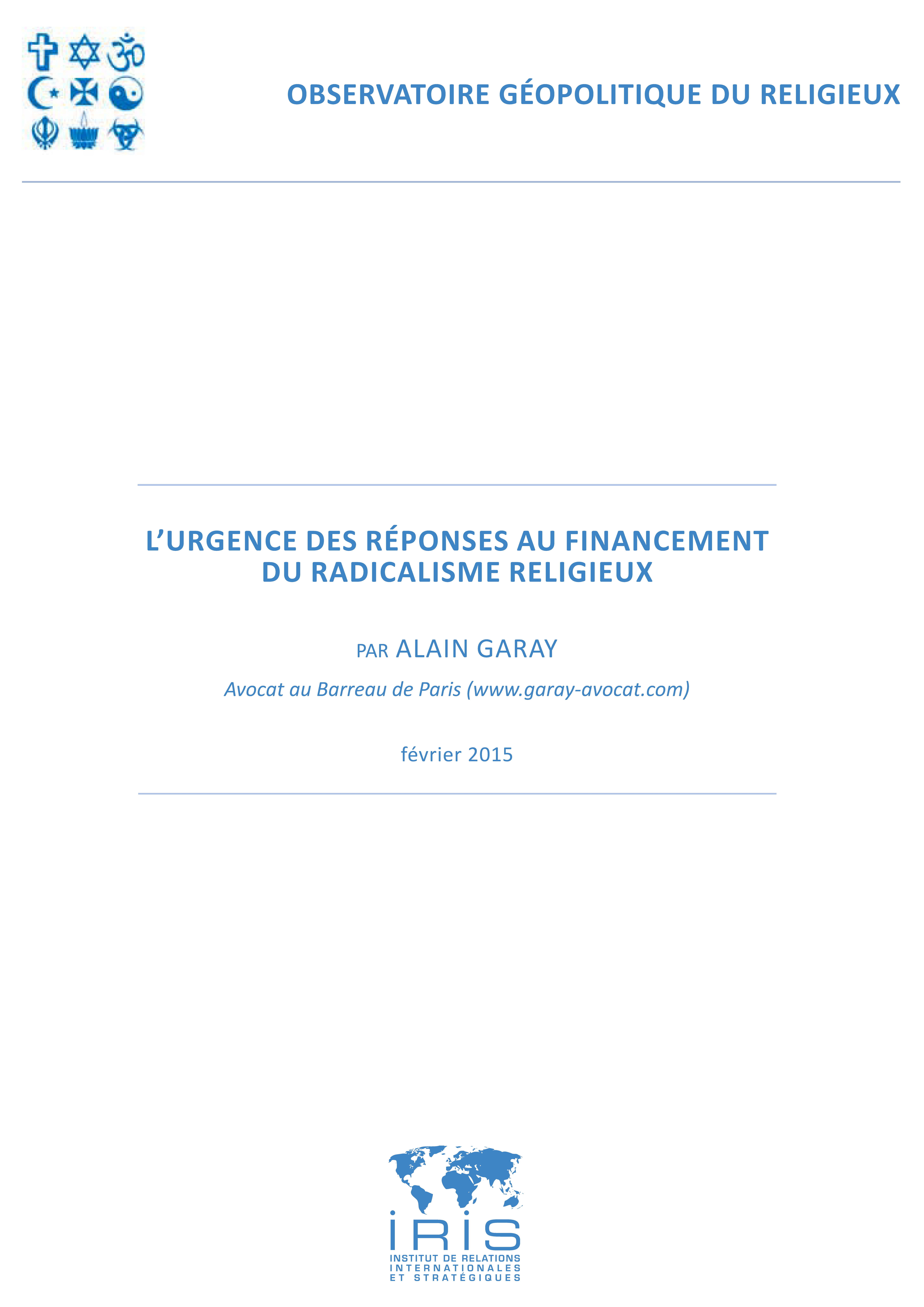
La définition polysémique du « radicalisme religieux » renvoie, au‐delà du droit qui en connait, à différentes approches politiques et sociales, variables, selon les contextes géopolitiques. La conjugaison des termes, « radicalisme » et « religion », explique aujourd’hui la mise en oeuvre d’une politique publique de prévention, de dissuasion et de répression, sans que l’on doive céder à des amalgames mortifères infondés entre « islam » et « terrorisme ». Le site du Gouvernement français créé au début de l’année 2015, référencé « www.stop‐djihadisme.gouv.fr », présente ainsi les expressions du radicalisme religieux : « Pour recruter les adolescents et jeunes adultes, garçons comme filles, les groupes terroristes utilisent aussi de véritables techniques de manipulation mentale. C’est cette stratégie qui peut apparenter les recrutements à une forme d’embrigadement sectaire. Ces techniques de manipulation ont pour but d’amener ces jeunes à rejeter progressivement leur environnement pour les isoler, les mettre sous l’autorité du discours radical et les convaincre. Ce sont des méthodes puissantes : des cas de radicalisation et de départs extrêmement rapides, en à peine quelques semaines, ont été observés. »

