Notes / Observatoire géopolitique du religieux
5 novembre 2014
Les persécutions religieuses dans la reconnaissance du statut de réfugié : le paradoxe des Ahmadis au Pakistan et du droit européen
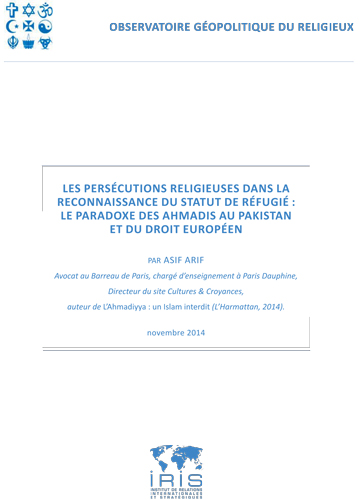
Véritable sésame pour les étrangers parcourant le monde pour rejoindre la France, le statut de « réfugié politique » n’est pas donné à tout le monde. D’abord, il faut ici préciser, que la qualification juridique du statut de réfugié « politique » n’empêche pas une personne victime de persécutions religieuses de solliciter un tel statut. La complexité de la matière réside tant dans l’enchevêtrement des normes, que dans l’absence de définition concrète posée par les conventions internationales chargées de régir en la matière. Parmi celles‐ci, on retrouve la convention‐phare, appelée depuis plusieurs décennies la Convention de Genève (1951). Cette convention établit le critère de persécutions religieuses sans pour autant en définir le contenu matériel, laissant ainsi le soin aux juges de venir fortifier la notion à l’aide de cas pratiques. Cette matière est, de longue date, riche de plusieurs jurisprudences. A l’heure de la prolifération du fait religieux dans le monde et de l’intérêt croissant que l’on porte à celui‐ci, les organisations non‐gouvernementales (ONG) n’ont pas hésité à pointer du doigt les persécutions subies par différentes branche religieuses, qu’il s’agisse des Baha’is en Iran ou encore des Ahmadis au Pakistan. Et le droit ne pouvait pas rester silencieux face à celles‐ci.
Dans cette étude, nous allons tenter d’approcher la substance de la notion de « persécutions religieuses » qui donne la faculté à un étranger, issu d’une minorité religieuse, d’obtenir le statut de réfugié politique au titre de la Convention de Genève. Cette découverte va s’opérer à travers l’analyse de la situation d’une minorité en particulier, celle de l’islam ahmadiyya. Il faut en conséquence partir du postulat du droit pakistanais pour tenter de déceler la nature des persécutions dont fait l’objet cette minorité et d’en induire la portée concrète que peuvent avoir ces persécutions sur le droit conventionnel de l’asile, notamment dans son contexte européen.

