Notes / Asia Focus
17 février 2022
Opéra et géopolitique : quelle stratégie pour les pays asiatiques ?
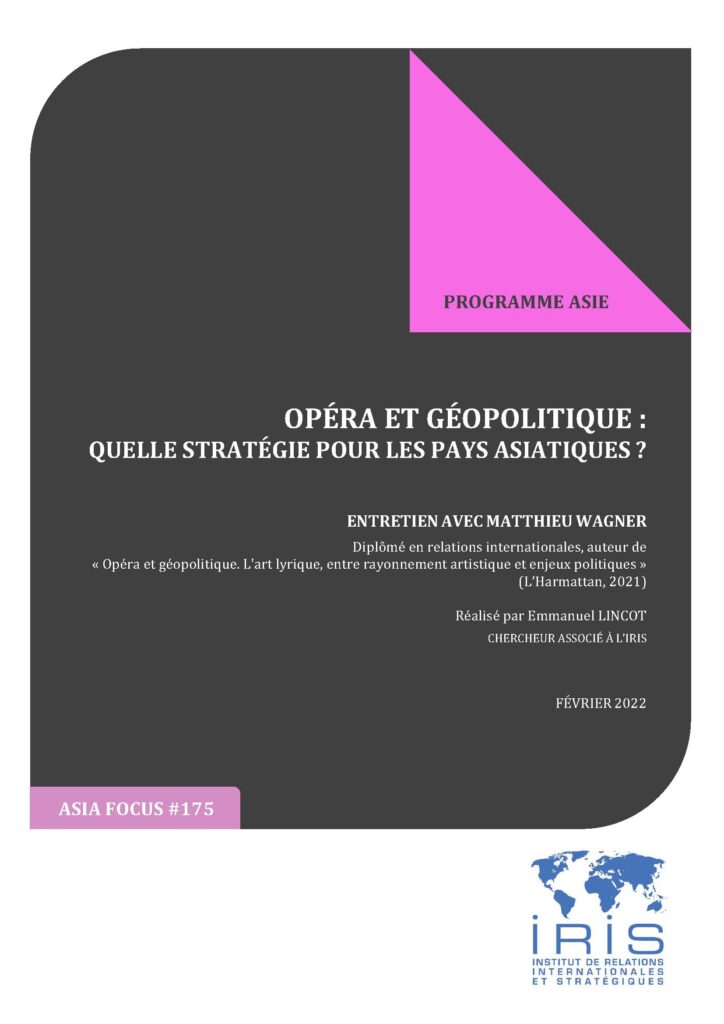
EMMANUEL LINCOT : Votre livre, Opéra et géopolitique aborde un phénomène musical mais aussi architectural qui avec la mondialisation a été promu depuis l’Europe aux quatre coins de la planète et se singularise chaque année davantage par des expressions vernaculaires que ce soit dans les mondes arabe ou chinois, entre autres exemples. La première de couverture de votre étude est d’ailleurs explicite par le choix de ses illustrations (l’opéra de Pékin construit par Paul Andreu et celui de Paris par Charles Garnier). Quelle signification politique donnez-vous à ce phénomène ?
MATTHIEU WAGNER : En effet, depuis les premières constructions d’opéras en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu’à l’inauguration de salles lyriques modernes en Chine ou au Moyen-Orient, le style architectural s’est constamment adapté à la culture nationale et locale. Pour illustrer le phénomène, les images de l’Opéra Garnier et l’Opéra de Pékin me semblaient intéressantes à mettre en parallèle, tant le contraste visuel est saisissant. Plus d’un siècle sépare les deux édifices : l’Opéra Garnier a été construit dans les années 1860/1870, entre la fin du Second Empire et le début de la IIIe République, celui de Pékin a été inauguré en 2007. Le souhait de Napoléon III à l’époque est d’offrir à la ville de Paris un nouvel opéra, plus visible que celui de la rue Le Peletier. On dit, par ailleurs, que la tentative d’assassinat en 1858 de Napoléon III, alors qu’il se rendait à l’Opéra, par le révolutionnaire italien Felice Orsini aurait décidé l’Empereur de construire un nouvel édifice aux abords plus sécurisés…

