Notes / Sport et géopolitique
22 décembre 2021
Manipulation des rencontres sportives : les actions du ministère français chargé des Sports
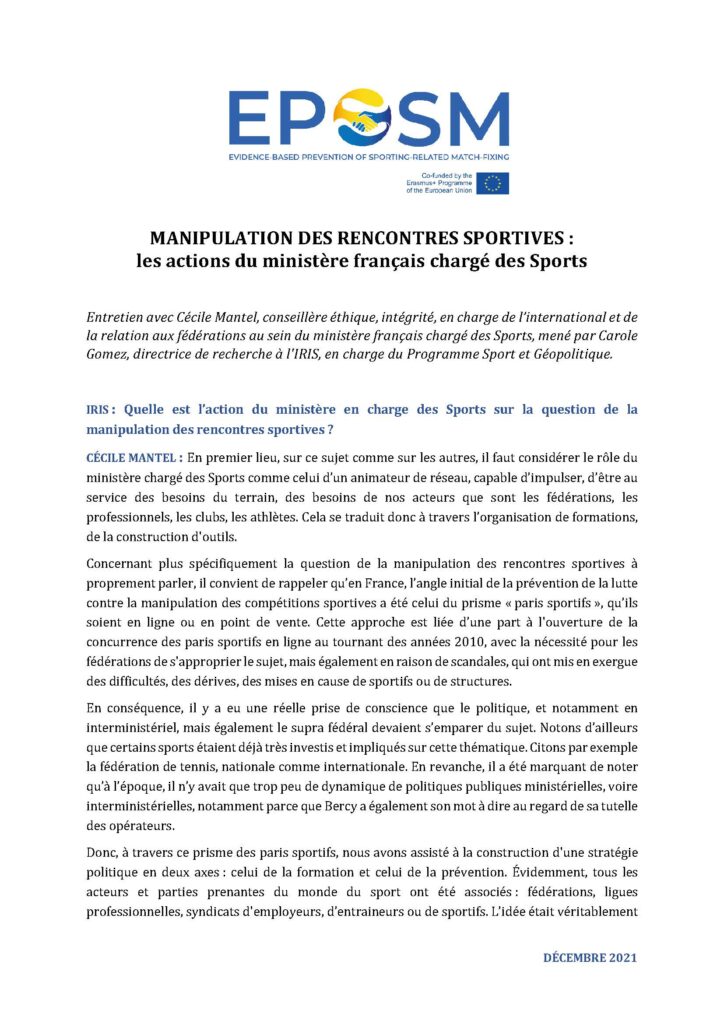
IRIS : Quelle est l’action du ministère en charge des Sports sur la question de la manipulation des rencontres sportives ?
CÉCILE MANTEL : En premier lieu, sur ce sujet comme sur les autres, il faut considérer le rôle du ministère chargé des Sports comme celui d’un animateur de réseau, capable d’impulser, d’être au service des besoins du terrain, des besoins de nos acteurs que sont les fédérations, les professionnels, les clubs, les athlètes. Cela se traduit donc à travers l’organisation de formations, de la construction d’outils.
Concernant plus spécifiquement la question de la manipulation des rencontres sportives à proprement parler, il convient de rappeler qu’en France, l’angle initial de la prévention de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives a été celui du prisme « paris sportifs », qu’ils soient en ligne ou en point de vente. Cette approche est liée d’une part à l’ouverture de la concurrence des paris sportifs en ligne au tournant des années 2010, avec la nécessité pour les fédérations de s’approprier le sujet, mais également en raison de scandales, qui ont mis en exergue des difficultés, des dérives, des mises en cause de sportifs ou de structures.
En conséquence, il y a eu une réelle prise de conscience que le politique, et notamment en interministériel, mais également le supra fédéral devaient s’emparer du sujet. Notons d’ailleurs que certains sports étaient déjà très investis et impliqués sur cette thématique. Citons par exemple la fédération de tennis, nationale comme internationale. En revanche, il a été marquant de noter qu’à l’époque, il n’y avait que trop peu de dynamique de politiques publiques ministérielles, voire interministérielles, notamment parce que Bercy a également son mot à dire au regard de sa tutelle des opérateurs.
Donc, à travers ce prisme des paris sportifs, nous avons assisté à la construction d’une stratégie politique en deux axes : celui de la formation et celui de la prévention. Évidemment, tous les acteurs et parties prenantes du monde du sport ont été associés : fédérations, ligues professionnelles, syndicats d’employeurs, d’entraineurs ou de sportifs. L’idée était véritablement d’essayer de construire quelque chose avec les fédérations les plus concernées car particulièrement ciblées ou parce qu’elles étaient à risque, notamment par rapport à l’écho médiatique et la caisse de résonance que des « affaires » pourraient avoir au-delà de notre seul territoire géographique.
Rappelons qu’à l’époque, il y a eu de gros débats en interne au sein des fédérations, sur la pertinence d’une approche commune : quel est le champ sur les types de paris sportifs et des compétitions françaises que l’on ouvre au droit aux paris ? Par exemple, au rugby ou au hand, des listes assez limitées sur les types de résultats ont été établies. Dans le cas du basket en revanche, la liste a été bien plus extensive dès le début. Cela peut aussi s’expliquer en raison de la pratique même du basket qui s’y prêtait plus : beaucoup de fautes, beaucoup de points marqués, de lancers francs, des interruptions de matchs, etc.
En revanche, les fédérations ont été d’accord sur la décision de fixer le curseur de la contrepartie du droit au pari, le fameux pourcentage de redevance sur le produit des jeux où initialement je pense qu’à peu près tout le monde était pour le 1%. Il y avait là une réelle approche stratégique face aux opérateurs de paris, où les fédérations considéraient de manière réaliste et pragmatique qu’un tel pourcentage de redevances sur les montants des paris enregistrés qui, dans la loi illustre les moyens que la fédération doit a minima consacrer aux enjeux de prévention à l’égard de l’ensemble des acteurs, était raisonnable.
Sur la question de la prévention, un axe intéressant me semble être celui du témoignage d’athlètes, qu’ils aient été sanctionnés, approchés ou repentis. Je reste convaincue qu’en termes de prévention, le témoignage d’un athlète qui parle à un autre athlète est la meilleure des préventions, et a fortiori quand il y a une interdisciplinarité, c’est-à-dire quand un tennisman ou une tenniswoman ayant fait l’objet d’approches peut venir témoigner auprès de jeunes handballeurs, basketteurs. Ce témoignage précieux sera toujours plus parlant pour un athlète que celui d’un représentant, d’un opérateur ou des pouvoirs publics ou même de sa propre fédération qui viendra lui faire la leçon. Il me semble que c’est vraiment un champ sur lequel on doit réussir à progresser en convainquant les personnes concernées qu’elles ont aussi des choses à y gagner.
Il est également essentiel de faire passer le message que personne n’est à l’abri. Le rôle des pouvoirs publics, des institutions sportives est, à mon sens, de devoir rassurer, d’essayer de trouver les meilleures circonstances pour pouvoir organiser ces temps de témoignages à travers des canaux différents.
Sur la question de la répression, il y a également des messages que l’on veut faire passer sur certains comportements.
Sur le versant formation, le ministère chargé des Sports a un levier direct qui est celui des diplômes d’État. L’un des questionnements auxquels on a été confrontés ces dernières années est de savoir comment aborder les choses : doit-on traiter en silo les types de dérives, c’est-à-dire des contenus spécifiques sur le risque de manipulations, le risque de conduites addictives, le dopage, la violence ou au contraire, essaye-t-on d’avoir une sorte de socle commun sur la prévention de l’éthique et l’intégrité dans le sport avec un système à tiroirs où en fonction de notre position (dirigeant, athlète, éducateur, arbitre), on viendrait tirer les éléments de formation qui nous concernent. Depuis 2 ans, c’est plutôt cette 2e approche que l’on essaie de privilégier, en formation initiale, comme en formation continue. Nous sommes en train de réfléchir à une sorte de PSC1 de l’éthique et de l’intégrité. Cela sera en quelque sorte un préalable à l’entrée dans les formations des diplômes d’État pour par exemple être éducateur sportif. L’idée serait d’avoir un ou deux jours de formation ou de sensibilisation à ce que va être l’environnement dans lequel va évoluer un éducateur. On va inscrire dans le cahier des charges d’habilitation des organismes de formation, l’obligation de délivrer des formations contenant des modules en matière d’éthique et d’intégrité. Si cela dépasse la seule question de la manipulation, l’idée est tout de même de construire un socle de connaissances, de références.
L’étape suivante concerne ce qui relève des diplômes fédéraux à destination des éducateurs, arbitres, dirigeants en l’abordant sous deux axes : construire des contenus avec nos partenaires qui participent aux groupes de travail organisés et animés par la direction des sports. L’idée est vraiment de convaincre de l’intérêt de ce type de contenus au sein des formations fédérales. Grâce à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le contrat de délégation va être mis en place avec les fédérations délégataires et il s’agira d’avoir un contrat d’engagements réciproques entre le ministère et les fédérations sportives, intégrant les obligations inhérentes aux missions de service public pour lesquelles un monopole est attribué par le ministère des Sports.
Notre objectif est que toutes les fédérations s’emparent de ce socle commun du « carré républicain du sport », à travers une stratégie nationale dont elles définissent les jalons temporels et les niveaux d’exigences. L’idée est vraiment d’engager les fédérations sur une trajectoire de progrès en leur faisant toucher du doigt qu’elles ont des responsabilités et qu’elles doivent s’emparer d’une stratégie de protection de l’intégrité des pratiquants comme des pratiques. À ce titre, le ministère met en place des outils, dont le guide AFNOR sur l’intégrité est une très bonne illustration. L’idée est désormais d’accompagner les fédérations pour la prise en main et voir comment chacune va s’en emparer. Le ministère est dans une logique d’accompagnement et souhaite pouvoir utiliser des leviers spécifiques (enveloppes budgétaires à l’ANS, cadres d’État, lobbying institutionnel, valorisation à travers des espaces de communication, etc.).

