Notes / Asia Focus
30 septembre 2021
Diplomatie et religions. Focus sur le cas indonésien
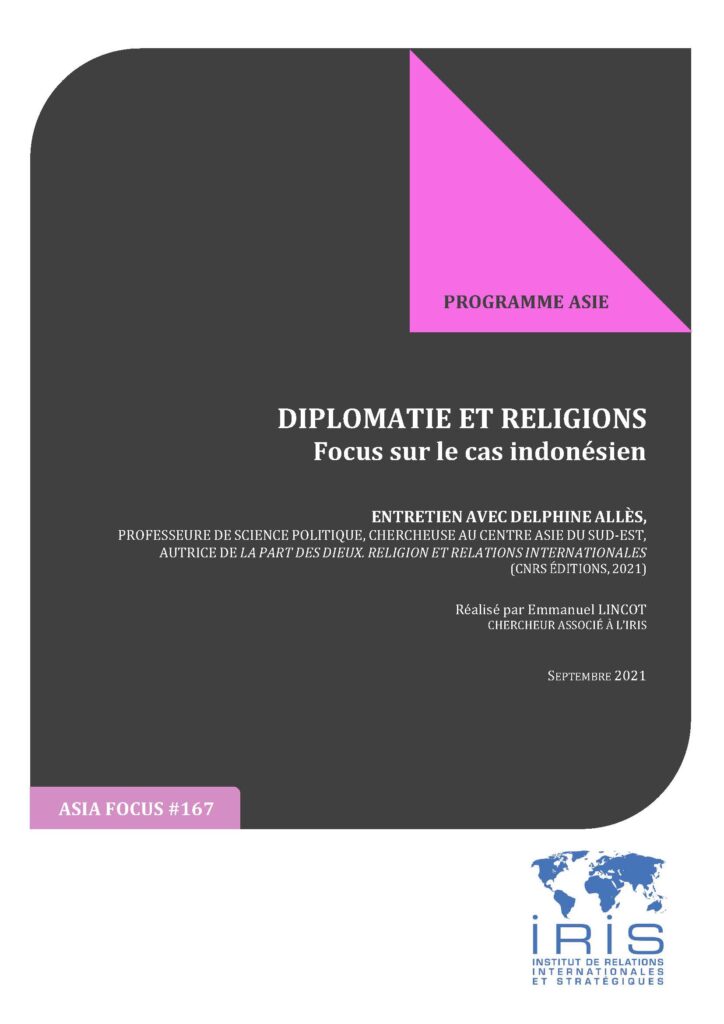
EMMANUEL LINCOT : Le paradigme, longtemps dominant, selon lequel la sécularisation serait le corollaire de la modernisation de la scène internationale, serait, selon vous, invalidé par un très grand nombre d’exemples illustrant, au contraire, un processus de confessionnalisation comme le montre la volonté pour la diplomatie indonésienne de s’ériger en pont entre les civilisations ou les religions. À quels phénomènes attribuez-vous cette confessionnalisation des relations internationales ?
DELPHINE ALLÈS : Après une longue période d’oubli, les religions sont désormais fréquemment invoquées à la fois comme une explication des humeurs du monde et comme la clé de leur apaisement. La notion de confessionnalisation décrit ce phénomène qui voit le facteur religieux érigé en variable indépendante, au centre des grilles d’analyse, mais aussi de nombreuses initiatives politiques internationales alors qu’il devrait être appréhendé comme un paramètre ordinaire, parmi d’autres, de la compréhension des sociétés et des fondements de leurs interactions. Pourquoi cette évolution est-elle plus manifeste depuis la fin de la guerre froide ? On peut identifier une tendance de fond, sur laquelle se sont greffés des déclencheurs plus circonstanciels. La tendance de fond est celle de la désoccidentalisation du système international…


