Analyses / Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique
4 mars 2025
Vers un règlement de la question kurde en Turquie ?
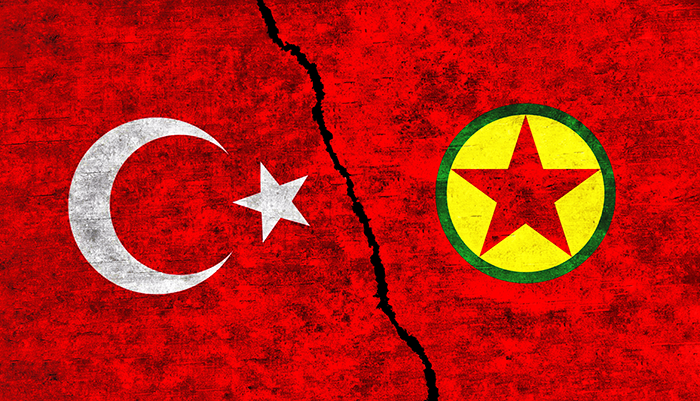
La déclaration d’Abdullah Öcalan du 25 février 2025, rendue publique par des parlementaires et dirigeants du parti kurdiste, le Parti de l’égalité des peuples et de la démocratie (DEM), deux jours plus tard fera date dans la déjà longue histoire de la question kurde en Turquie. Il semble toutefois prématuré de la qualifier d’historique.
Le contexte politique de la déclaration d’Abdullah Öcalan
À la surprise générale, c’est le dirigeant du Parti d’action nationaliste, d’extrême droite, Devlet Bahçeli, connu depuis des décennies pour sa constante et radicale opposition aux revendications kurdes, qui ouvre une nouvelle séquence politique en octobre 2024. Il déclare alors être favorable à ce que A. Öcalan puisse venir s’exprimer devant le Parlement pour s’adresser aux députés du Parti de l’égalité des peuples et de la démocratie ((DEM) et annoncer la fin de la lutte armée. Beaucoup de commentateurs se sont alors interrogés sur les raisons qui avaient poussé D. Bahçeli à prendre une telle initiative. Inexplicable en effet venant de sa part si on n’envisage pas une répartition des rôles calculée avec son allié politique Recep Tayyip Erdoğan. Ce dernier mit d’ailleurs quelques jours à réagir pour faire une première déclaration très vague sur la nécessité de tendre la main aux « frères kurdes » et ramener paix et concorde dans le pays.
Depuis, des parlementaires du DEM se sont rendus à trois reprises auprès d’Abdullah Öcalan dans l’île d’Imrali – dans la mer de Marmara, au sud d’Istanbul – sur laquelle il vit à l’isolement depuis 1999 ne recevant que de rares visites. Ces éléments constituaient indéniablement les premiers signes d’un apparent changement de posture sur le traitement de la question kurde. D’autant qu’au retour des visites auprès d’Öcalan, les parlementaires organisèrent des comptes rendus très médiatisés avec chacun des groupes politiques représentés au parlement.
Pour autant, totale impasse est faite à ce jour sur les conditions concrètes susceptibles d’ouvrir enfin un processus politique de négociations permettant d’aboutir in fine à un compromis et un accord. Les doutes sont d’autant plus forts que concomitamment à ces apparentes avancées une vague d’arrestations était organisée à l’encontre de maires du DEM, en raison de leurs liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Mardin, Batman, Halfeti étaient ainsi les premières municipalités touchées, ainsi que celle du quartier de Esenyurt à Istanbul, concernant cette fois un édile membre du Parti républicain du peuple (CHP), le parti kémaliste grand vainqueur des élections municipales de mars 2024. Le 26 novembre on apprenait l’arrestation de 231 personnes. Le 11 février, le maire DEM de Van était démis de ses fonctions et condamné à trois ans de prison. C’était le onzième maire ainsi destitué – neuf du DEM, 2 du CHP, principale formation de l’opposition –. Entre le 14 et le 18 février enfin, c’était quasiment 300 personnes qui étaient arrêtées, toujours pour les mêmes motifs, dans la quasi-totalité du pays. Ces quelques exemples illustrent assez bien le climat liberticide régnant en Turquie, totalement contradictoire avec les ouvertures d’Öcalan. Probablement s’agit-il pour le pouvoir de rassurer l’électorat nationaliste, par nature hostile aux revendications kurdes, dont on sait l’importance structurante croissante dans la vie politique et les résultats électoraux en Turquie, ce qui ne manque pas d’inquiéter quant à l’avenir du processus.
Le contenu de la déclaration
Intitulée Appel pour la paix et une société démocratique, la déclaration d’Abdullah Öcalan est courte. Évoquant la très ancienne cohabitation entre Turcs et Kurdes – plus de 1000 ans est-il rappelé –, revenant sur les raisons et le moment où le PKK a été créé, insistant ensuite à de multiples reprises sur l’importance fondamentale des valeurs, du modèle et des pratiques démocratiques, Öcalan marque une claire rupture avec quelques-unes des revendications qui ont été celles du PKK au cours de son histoire. Ainsi l’idée d’un État séparé, l’hypothèse d’une solution fédérale ou la perspective d’une autonomie administrative des régions du Sud-Est de la Turquie sont visiblement abandonnées. Il est frappant qu’aucune revendication proprement kurde n’apparaisse dans cette déclaration au profit d’appels, plus imprécis, à une vie démocratique et harmonieuse.
A contrario, c’est la pierre angulaire de la déclaration, est clairement formulé l’appel au dépôt des armes et à l’autodissolution du PKK, ce qui traduit un bouleversement radical de perspectives potentielles. Le contenu et la forme de cet appel semblent néanmoins indiquer un affaiblissement du PKK ce qui ne signifie pas, tant s’en faut, sa disparition du champ politique national et régional. Pour autant, le 1er mars, le PKK déclarait adhérer au contenu de l’appel d’Öcalan, décrétait un cessez-le-feu et convoquait un congrès dont « le succès sera conditionné à l’implication directe » d’A. Öcalan. La formule peut être interprétée de maintes manières…
Les conditions de véritables avancées ?
Au vu de la nature de cette déclaration, il est légitime de s’interroger sur sa signification et surtout sur les probabilités de sa concrétisation.
Il est en premier lieu utile de rappeler que ce n’est pas la première fois que des tentatives de résolution de la question kurde sont formulées en Turquie. Pour ne rappeler que celles des années Erdoğan : 2009, 2010-2011 et surtout fin 2012-été 2025 qui suscita un véritable espoir pour in fine échouer en raison d’enjeux électoraux intérieurs, véritablement pas à la hauteur des enjeux.
Le contexte est désormais différent, mais ne rend pas forcément plus optimiste. Alliance du parti de R. T. Erdoğan – le Parti de la justice et du développement (AKP) – avec l’extrême droite depuis 2015, considérables restrictions des libertés démocratiques depuis la tentative de coup d’État de 2016, constituent des éléments qui ne militent pas en faveur d’une solution négociée avec le PKK et le DEM.
L’appel d’Abdullah Öcalan au dépôt des armes et à l’autodissolution du PKK pose immédiatement deux questions principales. L’autorité incontestable, et incontestée, qu’il a longtemps exercé sur le PKK est-elle toujours efficiente, alors qu’il est emprisonné depuis 26 ans ? En d’autres termes, la direction militaire de l’organisation qui se trouve dans les monts Qandil, au nord de l’Irak, est-elle prête à obtempérer sans aucune garantie en retour ? Considérant l’histoire et le mode de fonctionnement du PKK, c’est peu probable.
Pour que quelque chance de réussite puisse se concrétiser, il est impérativement nécessaire que le pouvoir fournisse des éléments tangibles de réponse sans lesquels les positions resteront figées. Parmi les mesures envisageables, on peut en décliner plusieurs. Amnistie des prisonniers politiques accusés de complicités avec le PKK ; arrêt des multiples entraves à l’expression et aux activités des militants et responsables du DEM ; retour des élus démis du DEM dans leurs fonctions ; question de l’obtention des droits culturels et linguistiques pour les Kurdes ; avenir d’Abdullah Öcalan et de Selahettin Demirtas l’ancien dirigeant du parti prédécesseur du DEM, en prison depuis 2016. Ces mesures sont simples à énoncer, mais nécessitent des autorités d’Ankara volonté et courage politiques pour qu’elles soient décidées et appliquées.
La dimension régionale
C’est enfin un autre paramètre qu’il s’agit d’évaluer pour mesurer les chances de concrétisation d’un accord de compromis positif.
L’Irak tout d’abord. Une délégation du DEM s’est rendue le 16 février à Erbil pour y rencontrer le président de la région du Kurdistan d’Irak, Nechirvan Barzani, ainsi que Massoud Barzani président du Parti démocratique du Kurdistan d’Irak pour leur remettre un message d’Abdullah Öcalan. Ces dirigeants kurdes d’Irak – qui ont toujours eu des préventions à l’égard du PKK, le considérant comme un facteur perturbant dans la région qu’ils contrôlent –, seront-ils en situation d’influencer les chefs militaires de ce dernier pour accéder aux demandes d’Öcalan de déposer les armes ? Rien n’est moins sûr, cela dépendra fondamentalement des garanties effectives fournies.
La Syrie ensuite. C’est un aspect encore plus essentiel. Nous savons que le Nord-Est du pays, communément connu sous le nom de Rojava, est dirigé par les Forces démocratiques syriennes (FDS), structurées par le Parti de l’union démocratique (PYD), lui-même très proche du PKK. Des négociations difficiles existent depuis plusieurs semaines entre les nouvelles autorités syriennes et les FDS. Pour Damas, l’objectif principal est de préserver et de consolider l’unité du pays et il est donc vital de réduire l’autonomie du Nord-Est acquis durant la guerre civile et surtout obtenir que les structures militaires des FDS s’intègrent dans la nouvelle armée syrienne en voie de structuration. Les autorités de Damas dont nous savons la proximité avec Ankara sont dans une situation complexe : trop de concessions aux Kurdes de Syrie mécontenteraient les dirigeants turcs, trop d’attention aux exigences d’Ankara pour parvenir à la reddition des FDS empêcherait ces dernières d’accepter une solution négociée avec Damas. C’est précisément sur ce point que le rôle d’Öcalan peut être important. Si en réponse à son appel, des mesures réelles de démocratisation sont impulsées par Recep Tayyip Erdoğan, A. Öcalan pourrait alors tenter d’influer sur la direction des FDS pour qu’elle accepte les demandes des autorités de Damas. Pour autant, Mazloum Abdi, commandant en chef de FDS, a rapidement réagi à l’appel d’Öcalan en déclarant qu’il concernait le PKK et non la région kurde de Syrie.
C’est aussi pour ces raisons que toute possibilité de parvenir à des résultats positifs en Turquie dépend en partie de paramètres régionaux, expressions de la transnationalisation du fait kurde.

