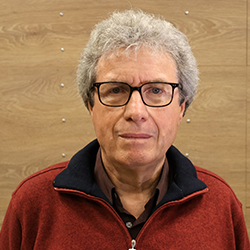Entretiens / Observatoire politique et géostratégique des États-Unis
17 juin 2025
Trump et sa guerre commerciale : entre échecs économiques et calculs politiques

Droits de douane excessifs, menaces de sanctions, négociation d’accords bilatéraux, réévaluation des devises de certains pays excédentaire…, les décisions de Donald Trump pour son second mandat redéfinissent les cartes des équilibres économiques alors qu’il s’en prend aux alliés traditionnels avec une politique protectionniste agressive. Dans quelle mesure l’efficacité de ces outils de pression économique peut-elle être remise en question au regard des expériences passées ? Ces décisions relèvent-elles d’un aventurisme économique ou sont-elles le fruit d’une ligne politique nettement tracée ? Quel impact aura cette guerre des tarifs douaniers sur les équilibres mondiaux ? Le point avec Philippe Barbet, économiste, professeur émérite à l’Université Sorbonne-Paris-Nord, chercheur associé à l’IRIS.
Les ambitions protectionnistes de Donald Trump étaient vastes à l’aube de son second mandat. Cette politique offensive était-elle inédite dans l’histoire des États-Unis ? Dans un contexte d’interdépendance accrue, l’imposition de droits de douane élevés constitue-t-elle toujours un outil de puissance efficace ?
Les États-Unis d’Amérique ont toujours entretenu une relation complexe avec la question de l’ouverture aux échanges économiques extérieurs. Comme de nombreux pays désormais développés (Japon, Corée, Allemagne, France…), le décollage de l’économie américaine s’est effectué au prix d’une forte protection de ses industries naissantes comme la sidérurgie. La théorie dite des « industries dans l’enfance » développée par l’économiste allemand Friedrich List en 1841 a été largement reprise par Alexander Hamilton dans son rapport sur les manufactures présenté au Congrès en 1791. Influencé par l’approche de Colbert en France, il préconisait une combinaison de droits de douanes et de subvention pour les industries naissantes considérées comme stratégiques. Ce protectionnisme dit « éducateur » ne devait toutefois pas perdurer et devait disparaître dès que l’industrie américaine sortirait de la phase initiale de son développement.
L’augmentation des droits de douane décidée par l’administration américaine actuelle ne s’inscrit pas dans cette tradition. Elle s’apparente même, avec des droits de douane importants dans la sidérurgie (passés de 25 % initialement à 50 %), à une forme de protection d’une industrie en fin de vie qui a par ailleurs la particularité d’être localisée dans des États dont les électeurs balancent entre les républicains et les démocrates (swing states).
Le président Trump n’a d’ailleurs pas fait référence à Alexander Hamilton lors de son investiture, mais au président McKinley, élu en 1896 qui a augmenté les droits de douane moyens de 38 % à environ 50 %. Cette augmentation, décidée à l’époque en partie pour augmenter les recettes de l’État fédéral, n’a pas eu l’effet escompté et McKinley lui-même l’a reconnu peu avant son assassinat en 1901.
La poussée de fièvre protectionniste suivante aux États-Unis date des années 1930 avec la loi Hawley-Smoot qui a augmenté les droits de douane et, en raison des mesures de rétorsion prises par les pays partenaires, contribué à la propagation de la profonde crise économique qui a ensuite touché les deux rives de l’Atlantique.
L’adhésion des États-Unis à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariff and Trade, GATT) en 1947 a ouvert une longue période de réduction des droits de douane puis des barrières non tarifaires aux échanges (quotas, contingents, utilisation protectionniste des normes…). Pendant la seconde moitié du XXe siècle, la politique commerciale américaine a été plutôt centrée sur la défense de secteurs spécifiques considérés comme stratégiques. Les conflits se sont multipliés avec les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. C’est notamment le cas avec le Japon dans l’automobile et les composants électroniques et avec l’Union européenne (UE) avec le long conflit opposant Airbus à Boeing sur le marché des avions de ligne. Le secteur de la sidérurgie, de moins en moins compétitif aux États-Unis, a également fait l’objet de multiples mesures de protection tant tarifaires que non tarifaires.
Parallèlement, le bilatéralisme s’impose dans les relations commerciales et les conflits aux dépens de la logique multilatérale du GATT, puis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC, 1995), de moins en moins soutenue par les États-Unis. L’organe de règlement des différends qui permet de résoudre les conflits commerciaux entre pays membres est en effet paralysé depuis 2011 par le refus des États-Unis de nommer un juge, sapant dès lors l’efficacité de l’OMC dans la régulation des échanges internationaux.
Toutefois, les droits de douane et la plupart des mesures protectionnistes restaient établis sur une base multilatérale et non discriminatoires, identiques quels que soient les partenaires commerciaux des États-Unis. C’est ce principe de base qui est brutalement remis en question par l’administration actuelle.
Recul sur les droits de douane imposés à la Chine, report de l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers sur les produits de l’UE, etc. Les annonces et reculs témoignent-ils d’une stratégie politique bien définie de la part de Donald Trump, ou davantage d’amateurisme comme certains la qualifient dans la conduite de sa politique économique ?
Il convient de rappeler que, dans la constitution américaine, le Président est en charge de la politique extérieure, et le Congrès, de la politique commerciale. Toutefois, comme ces deux politiques sont souvent imbriquées, les conflits entre le pouvoir exécutif et législatif ont été fréquents avec une tendance historique à la prise de contrôle de la politique commerciale par le président.
Formalisée dans le Trade Act de 1974, la politique commerciale des États-Unis est régulièrement réactualisée. Selon la loi, un certain nombre d’articles (notamment le 232 et 301) permettent à l’exécutif de prendre des mesures de rétorsions douanières envers les pays dont les pratiques commerciales sont jugées déloyales. Toutefois, son utilisation est soumise à un certain nombre de contrôles et les mesures sont généralement temporaires. Malgré ce cadre, la question de partage des compétences entre le législatif et l’exécutif est toujours d’actualité puisque le tribunal du commerce international a été saisi en mai 2025 par cinq importateurs américains qui contestent la légalité de l’utilisation par le président d’une loi d’urgence, l’International Emergency Economic Powers Act, pour augmenter les droits de douane généraux pourtant sous la juridiction du Congrès. La plainte souligne que les déficits commerciaux des États-Unis sont très anciens et que l’urgence à y répondre n’est pas avérée.
L’offensive du pouvoir exécutif est forte depuis l’élection de 2024 puisque les principales annonces en matière commerciale ont été faites de manière spectaculaire par le président Donald Trump. Les droits de douane, qui étaient devenus très faibles et n’étaient d’ailleurs plus un sujet majeur des négociations commerciales internationales, reviennent au centre de la politique américaine. Le président considère qu’ils sont une sorte de remède miracle pour résoudre des problèmes très différents : augmenter les recettes publiques (ils sont présentés comme un impôt payé par les firmes étrangères pour pouvoir vendre aux États-Unis) et remplacer l’impôt sur le revenus, « punir » des partenaires considérés « déloyaux » comme la Chine et l’Union européenne, agir comme une mesure de rétorsion contre les pays qui ne contrôlent pas l’entrée du Fentanyl aux États-Unis (Mexique et Canada) et enfin, inciter les firmes étrangères à s’implanter aux États-Unis et créer de l’emploi. Il est évident que mettre en cohérence ces différents objectifs relève de l’exploit.
Prenons l’exemple du premier : l’augmentation des recettes douanières. Lorsque les droits de douane sont très élevés, les importations se réduisent de manière importante et par conséquent les recettes douanières également. Le cas de la Chine est à cet égard intéressant puisque les tarifs sont montés, de manière progressive par un processus d’escalade. En effet, Washington les a augmentés fortement, et ce, jusqu’à 145 % en avril 2025, suscitant une réaction chinoise plafonnant à 125 %. À ce niveau, il n’y a que très peu d’échanges – et donc peu de recettes douanières entrant dans le budget des États-Unis – à espérer. Par ailleurs, ce niveau de droits aurait d’importantes répercussions sur les flux d’échanges entre les deux pays. Avec une augmentation très importante des prix pour les consommateurs américains, la tentation de contourner les droits de douane en passant par des pays tiers est forte et affecterait de nouveau les recettes. Face à cette réalité, ils ont été temporairement ramenés à 10 %, auxquels s’ajoutent les 20 % pour le trafic de Fentanyl afin d’avancer dans les négociations entre les deux pays.
La mise en place des droits de douane dits réciproques ou bilatéraux, c’est-à-dire différents selon les partenaires, a été expliquée de manière surprenante avec un tableau présenté par le président américain à la Maison-Blanche qui a pour le moins stupéfié la plupart des économistes. Rappelons que le principe même de droits réciproques est en totale contradiction avec la logique antérieure qui repose justement sur des droits négociés de manière multilatérale et qui sont, produit par produit, les mêmes pour tous les partenaires, ce qui interdit de fait toute forme de discrimination.
Les tarifs présentés pays par pays sont calculés, pour faire simple, en faisant un rapport entre l’excédent commercial de chaque État avec les États-Unis et ses exportations totales. Le pourcentage obtenu est ensuite divisé par deux, par « gentillesse », pour aboutir au niveau du droit appliqué à l’entrée des produits étrangers aux États-Unis, ceci pour chaque pays. Cette approche présuppose donc que le déficit commercial des États-Unis avec tous ses partenaires résulte de mesures déloyales qu’il faut corriger. Or, les déficits commerciaux bilatéraux proviennent surtout de l’existence d’une faible compétitivité des produits fabriqués aux États-Unis. Par ailleurs, prendre uniquement en compte le déficit commercial omet les échanges de services (logiciels, audiovisuel…) pour lesquels les États-Unis sont largement excédentaires.
À la lumière de ce premier semestre Trump, on constate que les droits de douane ont été présentés comme une recette miracle pour régler plusieurs problèmes affectant l’économie américaine. Les annonces spectaculaires et les reculs constatés semblent montrer qu’ils sont un moyen d’obtenir des concessions de la part des partenaires plutôt qu’une fin en soi. On pourra sans doute juger de leur efficacité réelle lorsque ces négociations auront abouti.
Quel est l’impact de la politique de Donald Trump sur l’économie américaine ? Plus largement, où la politique de guerre commerciale du président américain mène-t-elle le monde ? Dans quelle mesure assiste-t-on à un bouleversement de l’ordre économique mondial ?
L’économie américaine est structurellement déficitaire en matière d’échanges commerciaux et de budget. Le déficit commercial atteint en 2024 près de 920 milliards de dollars, en croissance de 17 % par rapport à l’année précédente. Pour sa part, le déficit budgétaire est de 1877 milliards et représente 6,2 % du produit intérieur brut (PIB). La politique commerciale menée par l’administration Trump vise à réduire les importations avec des droits de douane élevés, à négocier l’augmentation des importations de produits américains comme le gaz naturel en Europe, mais aussi à desserrer la contrainte budgétaire en augmentant les recettes douanières.
Pour Antoine Bouët, le directeur du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), les conséquences pour l’économie américaine de cette politique commerciale devraient pourtant être négatives. Des droits de douane plus élevés seront répercutés sur les prix des produits importés et alimenteront l’inflation. Les entreprises américaines qui intègrent dans leur cycle de production des composants importés verront leur coût de production augmenter et leur compétitivité baisser. Enfin, les multiples volte-face dans la conduite de la politique commerciale créent de l’instabilité et pourraient dissuader les investisseurs à s’implanter aux États-Unis, ce qui serait contraire aux objectifs recherchés.
L’impact de la politique menée par les États-Unis sur l’économie des autres pays n’est pas négligeable, mais ne doit pas être surestimé. L’économie étatsunienne représente 25 % de l’économie internationale et 13 % du commerce mondial. Ce commerce mondial est recentré sur de grandes zones qui échangent principalement entre elles. Ainsi, 70 % des exportations européennes sont à destination d’autres pays européens, des chiffres qui sont respectivement de 51 % pour l’Asie et 38 % pour l’Amérique du Nord. Les États-Unis sont donc certes un acteur économique majeur, mais leur retrait des règles du commerce international peut être contourné. La politique commerciale erratique de l’administration américaine éclaire par contraste, l’existence d’un pôle de stabilité attaché à un minimum de règles, au sein de l’Union européenne. Dans la mesure où de grandes avancées en matière de libéralisation multilatérale des échanges peuvent difficilement être envisagées à court terme avec une OMC en panne, il est peut-être temps que l’Europe s’engage clairement dans la conclusion des accords d’ouverture aux échanges avec de grands partenaires comme les pays d’Amérique latine regroupés au sein du Mercosur, avec les autres pays de l’Amérique du Nord et avec les pays d’Asie et du Pacifique.