Enjeux de société
Décembre 2018
Repenser la catégorie « bidonville ». De Damas à Yangon, les quartiers précaires à l’épreuve des politiques urbaines/ Par Valérie Clerc
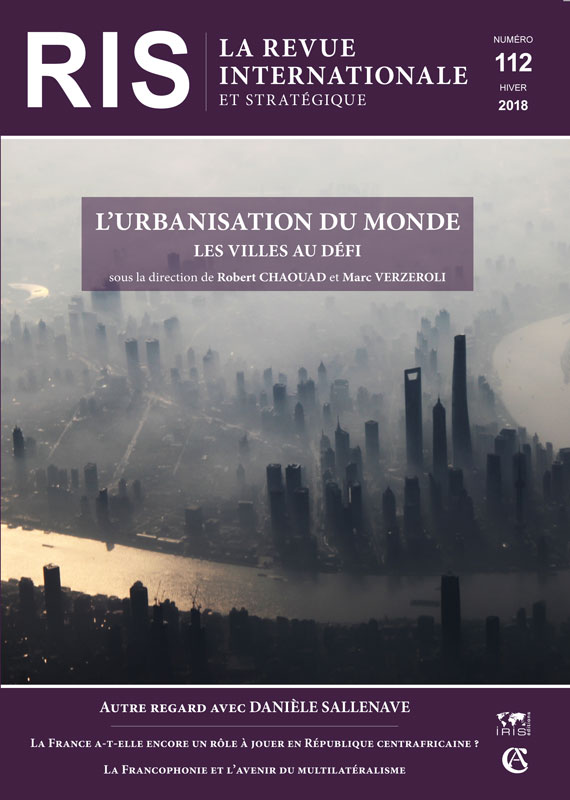 L’urbanisation du monde. Les villes au défi
L’urbanisation du monde. Les villes au défi
RIS 112 – Hiver 2018
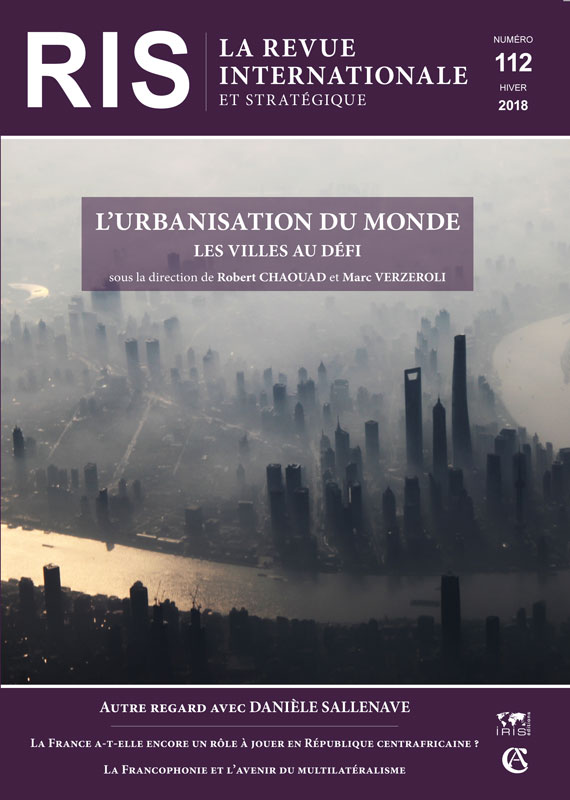
Depuis que bidonvilles et quartiers précaires existent, les pouvoirs publics cherchent à les faire disparaître et à en arrêter la croissance. Partout, politiques, lois, programmes ou projets ont cherché à rattraper cette urbanisation pour la réduire ou l’intégrer dans la ville légale. Les Nations unies se sont tôt saisies de la question du « logement inadéquat », en 1965 [1], et des « bidonvilles et établissements incontrôlés », en 1970 [2]. Dès la Conférence internationale sur les établissements humains, dite Habitat I, en 1976, elles ont invité les politiques à reconnaître cette urbanisation, à la réhabiliter, la régulariser et l’anticiper. Depuis sa création en 1978, le Programme des Nations unies pour les établissements humains – aujourd’hui ONU-Habitat – finance des programmes en suivant les injonctions formulées à l’échelle internationale, comme les objectifs du millénaire (2000) [3] et de développement dur
Cet article est en accès libre sur Cairn.


