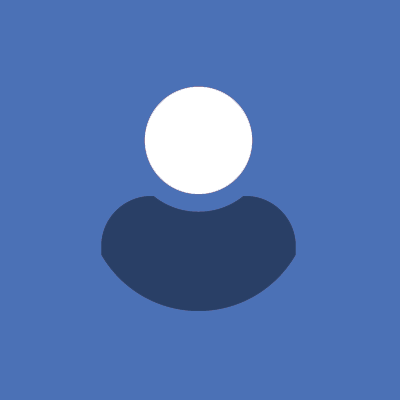Entretiens / Moyen-Orient / Afrique du Nord
27 novembre 2025
Israël, Hezbollah : le Liban face à une escalade annoncée ?

Le 23 novembre dernier, Israël a de nouveau frappé au-delà de ses frontières, visant cette fois-ci la banlieue sud de Beyrouth et tuant le chef militaire du Hezbollah, Haytham Ali Tabatabaï. Menée dans un secteur densément peuplé, l’attaque a fait cinq morts et 28 blessés selon le gouvernement libanais. Malgré un cessez-le-feu conclu il y a tout juste un an, le 27 novembre 2024, la frontière israélo-libanaise – longue de 79 km – demeure une ligne de tension depuis la création de l’État d’Israël en 1948. L’existence persistante du Hezbollah, milice chiite au cœur des équilibres politico-sécuritaires du Liban, fournit ainsi un motif récurrent pour les opérations extraterritoriales israéliennes. Alors que le Liban traverse une crise économique sans précédent et que son système politique, fragmenté par une mosaïque confessionnelle sociale, peine à affirmer son autorité, quelles capacités réelles le gouvernement possède-t-il pour répondre à ces violations répétées ? Quelles perspectives stratégiques se dessinent pour Israël, mais aussi pour les acteurs régionaux et internationaux – États-Unis, France, pays du Golfe – traditionnellement engagés dans la stabilisation du théâtre sécuritaire régional ? Le point avec Thomas Sarthou, analyste en stratégie internationale, diplômé d’IRIS Sup’.
Quelle est l’attitude et quelles sont les capacités actuelles du gouvernement libanais contre les opérations illégales d’Israël ?
Depuis la signature de cessez-le-feu entre Israël et le Liban le 27 novembre 2024, les violations israéliennes répétées suscitent une condamnation unanime de la part de la classe politique libanaise. Au sein du nouvel exécutif, au pouvoir depuis le 9 janvier dernier, les critiques les plus fermes à l’encontre de la stratégie du voisin israélien viennent directement du président de la République Joseph Aoun. Ce dernier a été le premier officiel libanais à réagir après les frappes, condamnant un pays qui « refuse d’appliquer les résolutions internationales » pour mettre un terme à l’escalade et appelant la communauté internationale à intervenir « avec force et sérieux ».
Au-delà de ces appels répétés à la communauté internationale, l’État libanais souffre d’une incapacité structurelle à imposer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire et à faire cesser les agressions israéliennes. Alors que l’accord de cessation des hostilités signé il y a tout juste un an prévoyait un retrait total des forces israéliennes du Sud-Liban, Tel-Aviv maintient cinq positions – qu’il qualifie lui-même de « stratégiques ». De plus, Israël multiplie les frappes sur des cibles liées au Hezbollah, de la zone frontalière du Sud en passant par la banlieue sud de Beyrouth, la Bekaa (Est du pays), jusqu’au Nord du Liban. Cette incapacité de Beyrouth à y répondre repose sur deux facteurs majeurs.
Premièrement, la faiblesse de son institution militaire. Sous-dotée en équipements et en effectifs, cette dernière souffre de l’une des « pires crises économiques de l’histoire moderne » selon la Banque mondiale. Alors que l’inflation est galopante depuis 2019, un soldat gagne en moyenne 60 dollars et doit donc souvent, pour subvenir à ses besoins, trouver un deuxième emploi. Ce déficit capacitaire chronique rend l’armée libanaise structurellement dépendante de l’aide étrangère, notamment celle des États-Unis dont les intérêts dans la région ne sont pas forcément en adéquation avec le développement d’une armée libanaise forte à la frontière israélienne.
Deuxièmement, l’État libanais ne peut actuellement se prévaloir d’un climat régional favorable pour le soutenir dans l’expression de sa souveraineté. Joseph Aoun le sait d’autant mieux qu’il a fallu le plébiscite de cinq puissances régionales et internationales pour qu’il accède à la fonction suprême, après deux années de vacance présidentielle[1]. Or, les membres du « Quintette », à savoir les États-Unis, la France, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Qatar, ont diminué leur soutien.
Les capitales arabes demeurent dans l’expectative face un hubris israélien toujours plus affirmé dans la région. Riyad et Doha conditionnent toujours leur aide économique pour reconstruire le Liban à des avancées significatives sur le dossier du désarmement du Hezbollah et à des mesures concrètes pour mettre un terme au trafic de captagon qui transit de la Syrie au Golfe, en passant par le Liban. L’Égypte, qui bénéficie de l’atout diplomatique de discuter à la fois avec Israël, l’État libanais et le Hezbollah, tente actuellement d’amorcer une dynamique régionale – comme le montre la visite de son ministre des Affaires étrangères à Beyrouth deux jours après l’attaque. Mais son poids économique et politique demeure trop faible pour en espérer un quelconque élan significatif.
Quant à la France, qui co-préside avec les États-Unis le comité chargé de surveiller la mise en application du cessez-le-feu, elle perd de plus en plus sa crédibilité à mesure qu’Israël poursuit ses violations. C’est ce qu’a notamment indiqué Joseph Aoun à la conseillère d’Emmanuel Macron, Anne-Claire Legendre, début novembre : le « soutien moral » affiché par la France ne suffit plus. Car, si la diplomatie française se montre aux avant-postes sur tout une série de dossiers majeurs (organisation de conférences pour soutenir l’armée et pour la reconstruction, réformes en vue de mettre en place un programme avec le Fonds monétaire international (FMI), relations entre Damas et Beyrouth) les décisions fortes se prennent à Washington, non à Paris. Un exemple récent éclaire bien cette situation : la décision du prolongement du mandat de la Finul cet été. Alors que la France liait le retrait de la force onusienne au contrôle effectif de l’ensemble du territoire libanais par l’État, les États-Unis de Donald Trump ont obtenu un retrait sine qua non dès l’année prochaine.
Finalement, Washington dicte le tempo et s’impatiente sur le dossier du désarmement. L’administration Trump a fixé comme date butoir la fin d’année pour saisir l’arsenal du mouvement chiite et propose de parrainer des discussions bilatérales entre Tel-Aviv et Beyrouth. La semaine dernière les États-Unis ont annulé toute une série de rendez-vous entre officiels américains et l’actuel chef de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal. Reprenant la rhétorique israélienne, ils reprochent à l’armée libanaise ne pas être assez active dans le démantèlement de la milice.
Justement, quelles sont les dernières avancées de ce processus et qu’en est-il des capacités militaires actuelles du Hezbollah ? Comment cette dynamique est-elle perçue au Liban ? Pourrait-elle aggraver sa stabilité interne ?
Il est très difficile, au vu des informations dont nous disposons, d’évaluer l’ampleur des capacités militaires du Hezbollah. Une chose est certaine, le mouvement chiite a été durement touché par la guerre de haute intensité de 66 jours que lui a livré Israël entre mai et novembre 2024. Sur le plan militaire, c’est incontestablement une défaite pour le Hezbollah, qui était jusqu’alors le seul acteur de la région à revendiquer un succès militaire face à Israël en 2006. Cette défaite a atteint son apogée avec l’attaque dite des « bipeurs » du 17 septembre 2024 et la mort de son charismatique[2] secrétaire général, Hassan Nasrallah, 10 jours plus tard. Elle s’est traduite, sur le plan politique, par une diminution de son influence et par la nomination du général Joseph Aoun à la présidence.
Ce que montre cependant la dernière attaque israélienne qui a tué Haytham Ali Tabatabaï, haut-commandant de la force d’élite du Hezbollah, c’est que la chaine de commandement de la milice n’a pas été totalement décimée. Certains observateurs notent même que la quasi-totalité des officiers et sous-officiers qui ont été assassinés durant la guerre ont été remplacés. Cependant, les allégations de médias israéliens et américains selon lesquelles la milice continue de se renforcer sont à manier avec précaution. D’un point de vue strictement matériel, la chute du régime Assad en Syrie – qui servait auparavant de hub pour acheminer les armes – et les restrictions sur le port de Beyrouth mises en place par les nouvelles autorités libanaises, rendent difficile l’approvisionnement.
En ce qui concerne les avancées liées au désarmement du groupe, les chiffres sont également sujets à caution. Selon les déclarations des autorités libanaises, plus de 90 % des infrastructures liées au Hezbollah ont été démantelées au Sud du fleuve Litani (qui traverse le Sud-Liban d’Ouest en Est). D’après ces mêmes autorités, les opérations se seraient faites en coopération avec la milice. La Finul, qui a pour mission depuis 1978 « d’aider le gouvernement libanais à assurer la restauration de son autorité effective », corrobore ces informations et, dans son dernier rapport, salue les progrès accomplis par l’armée libanaise sur le désarmement. Cependant, la question centrale n’est pas tant de savoir si le processus de désarmement progresse mais quelle doit être sa portée.
Ici, deux lectures de l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024 s’opposent. La première, partagée par Washington, Tel-Aviv et certains acteurs de la scène politique libanaise, considère que le démantèlement doit se faire « en commençant par la zone sud du Litani » (art. 7.a) et que, par conséquent, il vise à terme l’entièreté du territoire libanais. En face, le Hezbollah et ses alliés rétorquent que la résolution onusienne 1701 sur laquelle se base l’accord n’implique que le sud du pays. Le gouvernement libanais a finalement tranché la question. Le 5 septembre dernier, il a chargé l’armée d’établir un plan en cinq étapes débutant par le sud et visant à s’étendre au reste du pays. Cette décision a provoqué le mécontentement des ministres chiites du gouvernement qui ont décidé de quitter la réunion avant la déclaration finale.
Ainsi, tant au sein de la population que de la classe politique, le principe selon lequel le monopole des armes doit revenir à l’État fait l’unanimité. Le Hezbollah et ses partisans ne rejettent pas le démantèlement en soi, mais ses modalités. Ils critiquent la façon dont est actuellement abordée la question du désarmement par le gouvernement : elle ne doit pas constituer une « réponse à des exigences étrangères ou à un chantage israélien » mais plutôt être incluse dans un « consensus sur une stratégie globale de sécurité, de défense et de protection de la souveraineté nationale». De l’autre côté du spectre politique, certains partis chrétiens frontalement opposés au Hezbollah – et récemment auréolés de leur victoire aux élections municipales – plaident pour un désarmement immédiat, global et sans dialogue.
Dans ce climat de polarisation politique, les lignes de fracture confessionnelles ne tardent jamais à réapparaître. Joseph Aoun l’a bien compris et il tente d’incarner une position centrale et de compromis. Dans son adresse à la Nation la veille du 82ᵉ anniversaire de l’indépendance ce 21 novembre – prononcé exceptionnellement au Sud-Liban – il a renvoyé dos à dos les deux camps et a expliqué vouloir défendre « les intérêts de la patrie et de tout le peuple ». Mais, face à l’incapacité de l’État à protéger efficacement ses citoyens des agressions israéliennes, ce discours apparaît de plus en plus fragile.
Une escalade israélienne dans le sud du Liban est-elle possible dans un futur proche ?
Depuis le 7 octobre 2023, Tel-Aviv mène une stratégie régionale d’escalade. Celle-ci peut être observée dans la réponse asymétrique à Gaza et vis-à-vis des territoires palestiniens occupés, mais également en Syrie, en Iran et dans les récentes attaques ayant visé le Qatar. Au Liban, un seuil supplémentaire serait franchi si Israël décidait d’à nouveau bombarder massivement le pays et ses infrastructures ou de faire avancer ses troupes au sol comme cela a été le cas en 2024. L’hypothèse n’est pas exclue par les dirigeants libanais. Ce 25 novembre, le Premier ministre libanais a déclaré que son pays était en situation de « guerre d’usure unilatérale » et qu’il prenait toutes les « précautions pour faire face à toute escalade et à ses conséquences humanitaires, sociales ou autres ».
C’est d’ailleurs ce que menacent explicitement de faire les dirigeants israéliens. Ce 26 novembre, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti que Tsahal interviendra « avec force » au Liban si le Hezbollah n’est pas désarmé « d’ici la fin de l’année ». Il est cependant difficile d’affirmer que Tel-Aviv est prêt à s’engager dans un nouveau conflit de haute intensité au Liban, notamment au sol. Après l’annonce récente du lancement par Tsahal d’une vaste opération en Cisjordanie, l’ouverture d’un troisième front simultané peut s’avérer difficile à gérer pour une institution militaire déjà épuisée par plus de deux années de guerre.
À cet égard, il faudra surveiller attentivement l’attitude des États-Unis qui, pour l’instant, adoptent une position relativement conciliante vis-à-vis de la politique belliciste de Benyamin Netanyahou au Liban. Quels seraient les intérêts américains à laisser Israël envahir le Sud-Liban ? L’administration Trump, dans sa stratégie d’apporter une stabilité favorable aux affaires dans la région, semble désormais plutôt se tourner vers la Syrie. Joseph Aoun le sait bien et, dans son adresse à la Nation, il a averti les Libanais que « le monde était sur le point de se lasser de nous ».
Quels seraient ceux d’Israël ? Tel-Aviv défend que les cinq positions qu’il conserve dans le Sud du Liban sont « stratégiques ». Mais cela fait bien longtemps que la possession de points en hauteur n’offre plus l’avantage décisif qu’elle représentait autrefois, comme le montre l’usage massif des drones par Tsahal au Liban. L’occupation israélienne actuelle joue plutôt un rôle de levier de pression sur le gouvernement libanais. La création d’une zone tampon au sud pourrait servir de monnaie d’échange pour négocier une paix asymétrique – à l’instar de ce que tente de faire Israël en Syrie en occupant le Golan et ses alentours.
En somme, une escalade ne peut être exclue : elle reste suspendue aux choix d’Israël et à l’attitude des États-Unis, dans un contexte où le Liban n’a que très peu de prise sur les dynamiques qui le traversent.
[1] Lors de la session de vote, un aréopage de délégations diplomatiques trônait symboliquement au-dessus des parlementaires libanais, leur présence servant implicitement de caution à l’élection du futur président.
[2] Au sens wébérien, c’est-à-dire détenteur d’une autorité fondée sur la personnalité et le prestige.