Notes / Asia Focus
27 avril 2017
Géoculture et histoire des idées. A propos de « Confucius ou la science des princes »
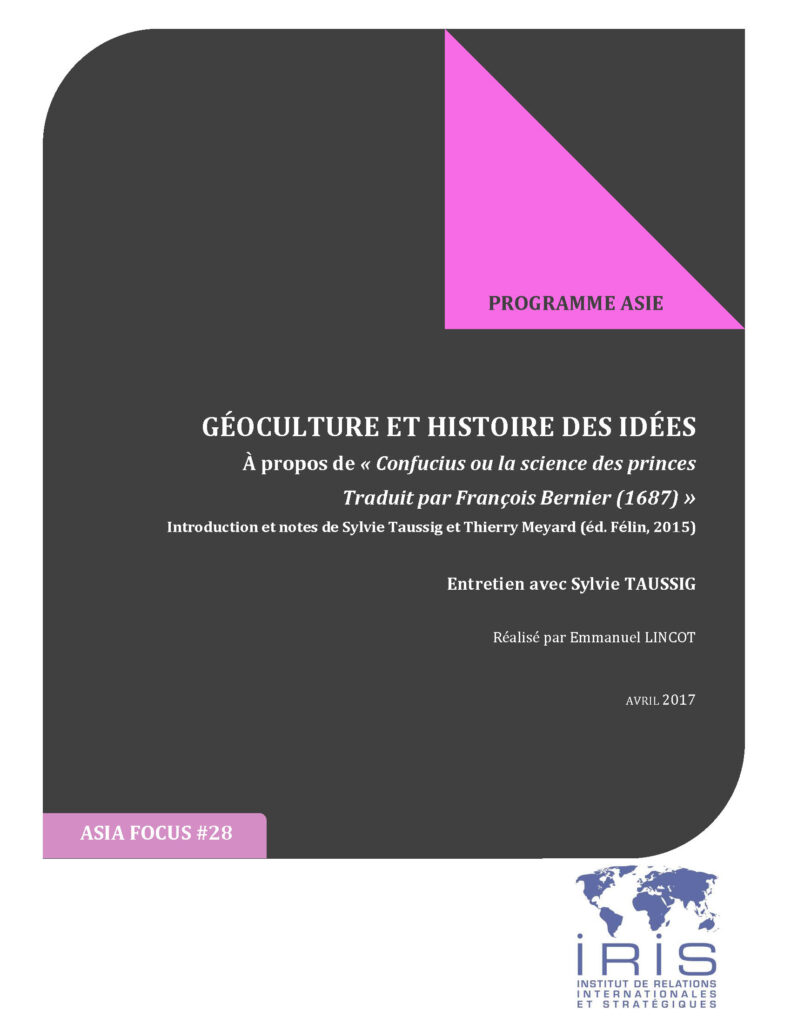
EMMANUEL LINCOT : Dans votre très riche introduction, vous rappelez que la politique étrangère de Louis XIV vise à « relever au profit de la France le patronage des missions jésuites en Chine dont la papauté avait auparavant chargé le Portugal » (p. 17). Comment expliquez-vous cet intérêt de la France d’alors pour la Chine ? Ne faut-il y voir qu’une stratégie impérialiste ou un enjeu idéologique dans la rivalité qui oppose notamment les jésuites aux jansénistes ?
SYLVIE TAUSSIG : Nous devons d’abord souligner les raisons commerciales qui font que la France recherche au-delà de l’Inde à établir de nouveaux comptoirs. Ainsi, Louis XIV envoie deux ambassades au royaume du Siam (aujourd’hui la Thaïlande) en 1684 et en 1686. De plus, Louis XIV met en place une politique scientifique ambitieuse. Grâce à l’intermédiaire de François de la Chaise, confesseur de Louis XIV, le jésuite Couplet de retour de Chine avec le manuscrit du Confucius Sinarum philosophus – traduction latine des classiques confucéens que Bernier va traduire à son tour en français – rencontre Louis XIV à Versailles en septembre 1684. Le projet d’envoyer des jésuites français pour travailler à l’Observatoire de Pékin se met alors en place. Envoyés comme « mathématiciens du roi », ils sont les correspondants de l’Observatoire de Paris, créé par Louis XIV en 1666 et dirigé depuis 1672 par Giovanni-Domingo Cassini. Les jésuites sont notamment chargés de faire des relevés très précis des positions géodésiques afin de perfectionner le calcul des longitudes. Melchisédech Thévenot, en charge de la Bibliothèque royale (l’ancêtre de la présente BNF), avait nourri depuis longtemps un intérêt pour les textes confucéens. C’est pourquoi, quand il est mis au courant des plans de Couplet pour faire publier les textes confucéens à Rome, il contacte l’ambassadeur de France auprès du Vatican, le Cardinal d’Estrées, pour que le projet de publication soit transféré à Paris. Ce n’est donc pas un hasard si Couplet passe deux années à Paris pour travailler à l’édition finale du Confucius Sinarum philosophus, publiée par la Bibliothèque royale. Mais ce n’est pas Louis XIV qui est à l’origine de l’intérêt pour la Chine ; celle-ci est déjà présente depuis une cinquantaine année, notamment depuis la publication de l’Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine de Matteo Ricci et Nicolas Trigault (original en latin publié en 1615 ; traduction française en 1617). La référence à la Chine envahit le discours littéraire et philosophique, l’espace des salons également, et progressivement sert à de multiples propos. Par ailleurs, la Chine constitue un nouveau champ du savoir. En fait, l’irruption de la Chine, que ce soit comme objet de connaissance ou comme référent symbolique, conduit à des remaniements profonds dans la manière qu’ont les Européens de se comprendre ; à commencer par le choix de la Septante contre la Vulgate au respect de la chronologie de l’histoire du monde. En effet, d’après les informations des jésuites, l’histoire de la Chine est antérieure à la date de création du déluge, ce qui est perçu comme un défi à l’autorité de la Bible version Vulgate. Une des interprétations qui circulent est que les Chinois qui avaient une connaissance de Dieu dans les temps anciens auraient par la suite perdu la foi monothéiste pour se régler suivant des rites purement civils et religieux. Il faut donc en conclure qu’il serait possible d’avoir une morale et une politique déconnectées de la religion…


