Notes / Sport et géopolitique
4 janvier 2017
De la responsabilité sociétale du sport
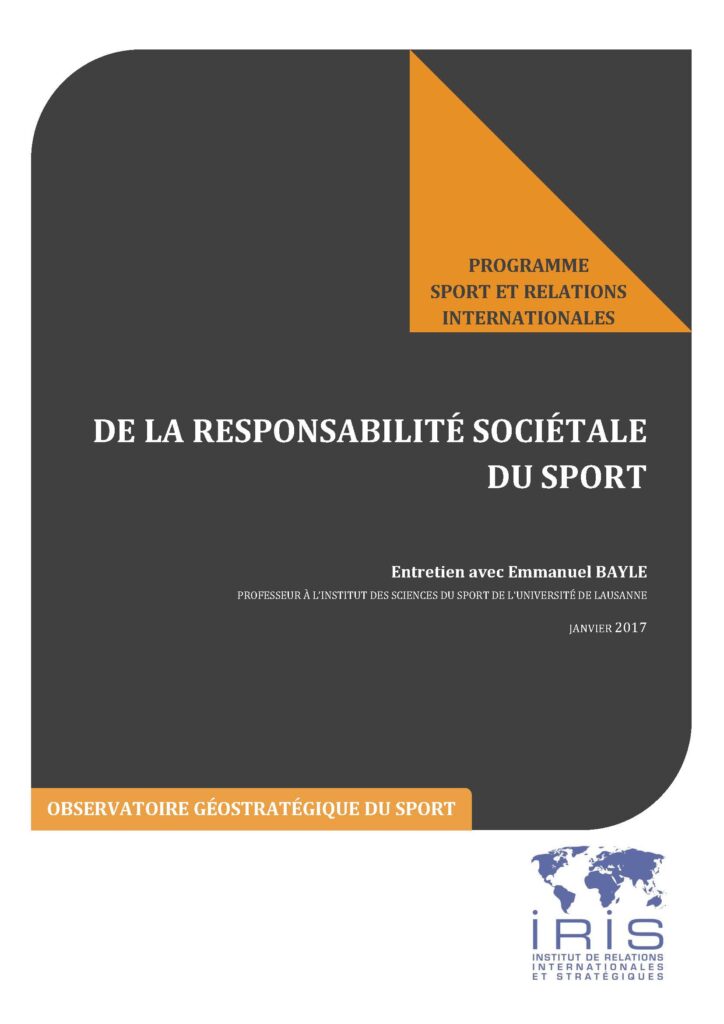
IRIS : Tout en promouvant ce changement, vos travaux décrivent la tendance des organisations sportives à prendre en compte « l’impact sociétal » dans le calcul de leur performance. Qu’entendez-vous par là ?
EMMANUEL BAYLE : Les fédérations nationales ou internationales, ou des structures comme des clubs ou des ligues professionnelles ont sous-estimé l’importance du calcul et de la mesure de la réussite de leur organisation. Pourtant, cette question est fondamentale. Et à ce titre, leurs performances ne se limitent pas aux résultats financiers et sportifs, comme elles ont eu tendance à le croire. Mais elles doivent s’étendre à un troisième pilier : la performance sociétale, à savoir l’impact économique, social et environnemental de leurs activités. Comment mesurer cet impact sur la durée ? Par exemple au-delà des médailles remportées, il faut aussi analyser les taux de reconversion professionnelle des athlètes, les formes d’engagements de ces athlètes vis-à-vis de leurs structures d’accueil. Au terme de leur carrière sportive, les athlètes ont été marqués par ce qu’ils ont vécu, ils ont développé des compétences et des expériences sur lesquelles les organisations ne capitalisent pas suffisamment. Ce lien social doit être entretenu et ne pas se cantonner aux résultats sportifs. L’impact du sport sur son environnement est aussi économique, sanitaire, éducatif, etc.
Certaines initiatives ont été mises en place par les organisations sportives, mais il s’agit souvent de réactions à des scandales, avec des indicateurs partiels et critiquables. On peut se retrouver dans un discours incantatoire. Mais au moins on voit qu’une préoccupation pour les éléments sociétaux émerge dans le milieu sportif. Des rapports sur la responsabilité sociétale voient le jour, la norme ISO 26000 est désormais appliquée au sport. Le temps est mûr pour ce changement…

