Notes / Sport et géopolitique
25 avril 2019
La Coupe du monde à 48 : illustration de la géopolitique de la FIFA
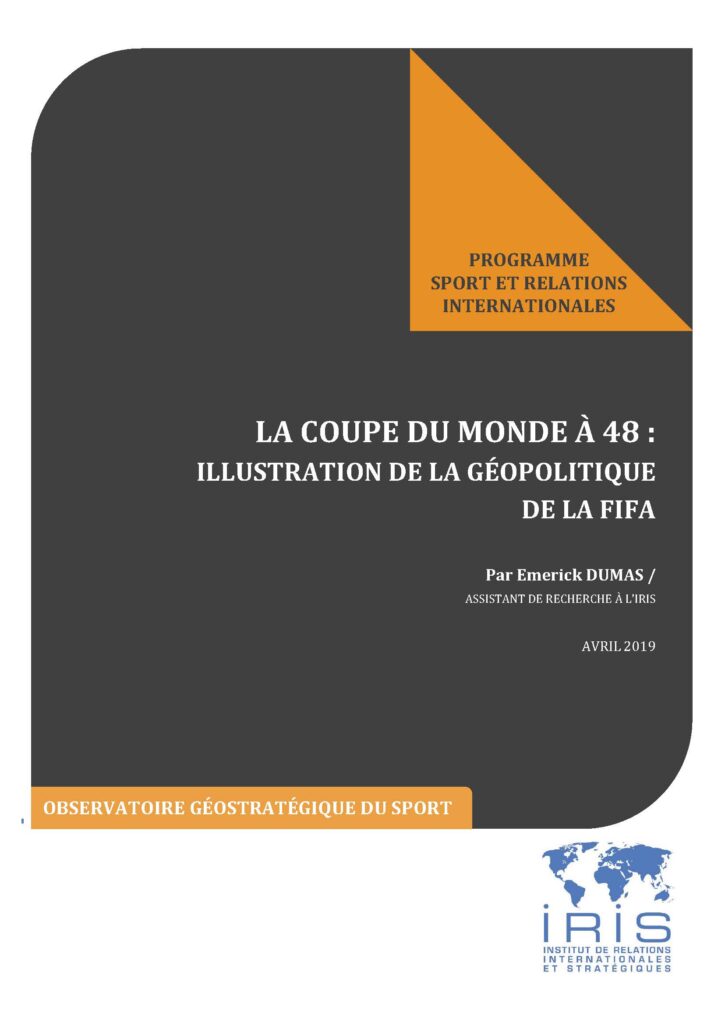
En janvier 2017, le conseil de la Fédération internationale de football association (FIFA) a adopté à l’unanimité la réforme de la Coupe du Monde qui fait passer le nombre de participants de 32 à 48. Ce n’est pas la première fois que la FIFA élargit l’accès de sa compétition phare. D’abord débutée à 16, elle passe à 24 en 1982 lors de la Coupe du monde en Espagne. En 1998, elle s’élargit jusqu’à 32 participants. Le projet d’accroissement à 48 nations était envisagé pour l’édition 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Néanmoins, à l’approche de l’édition qatarienne en 2022, la question d’une accélération du processus se pose. La décision doit être prise lors du congrès de la FIFA à Paris le 6 juin 2019. C’est lors de ce même congrès que Gianni Infantino va se représenter. Le projet d’élargissement de la compétition induit une nouvelle répartition des places qualificatives attribuées aux différentes confédérations. Lors de l’annonce de l’adoption par le Conseil de la FIFA d’un passage à 48 équipes pour la Coupe du monde en janvier 2017, Gianni Infantino, président de la FIFA, explique que « le football ne se limite pas à l’Europe et l’Amérique latine ». Cela montre une volonté de développer le football en dehors de ces confédérations. Bien qu’il essaie de montrer qu’il est nécessaire de ne plus se focaliser sur les deux confédérations, démontrant une volonté de modifier, il met néanmoins en avant l’importance des deux continents dans le football. De même, s’il semble inclure les autres confédérations, une différenciation est perceptible et illustre les politiques de la FIFA. Il ne s’agit pas de s’intéresser aux politiques qui guident ces choix, mais davantage d’étudier la corrélation entre les politiques de la FIFA et la répartition des places dans le projet de Coupe du monde à 48…

