Notes / Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique
5 octobre 2017
La politique étrangère de la Turquie à l’épreuve des crises du Moyen-Orient
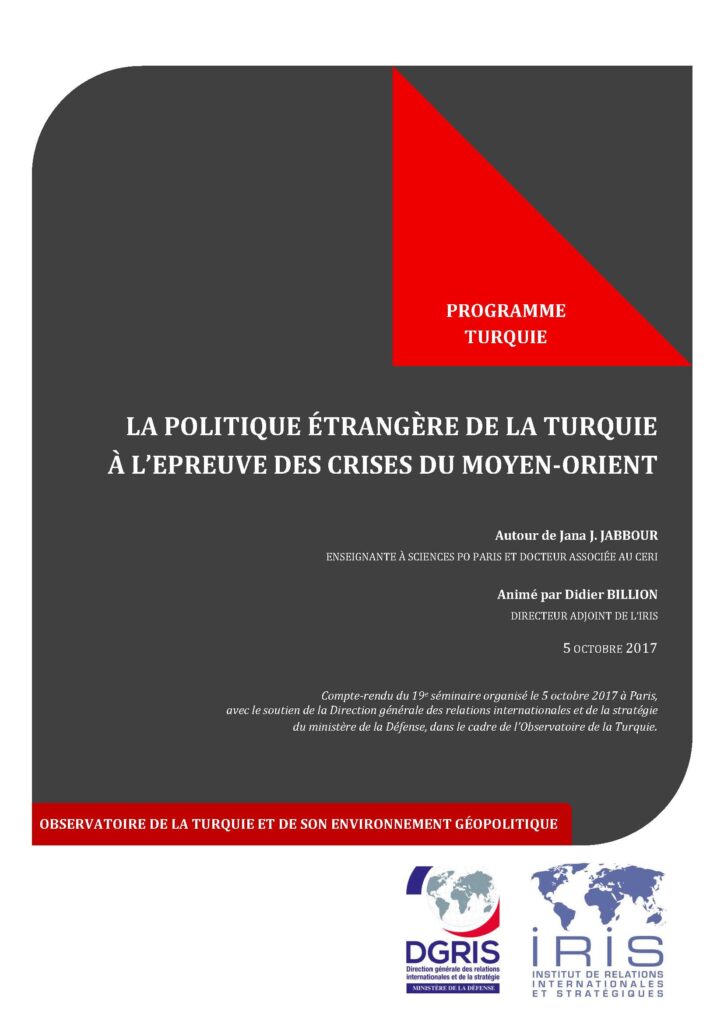
Durant une longue période, la République de Turquie, tout à la volonté d’occidentalisation du régime kémaliste, a tourné le dos à son environnement moyen-oriental. Pour autant, dès les années 60, une volonté de diversification des axes de sa politique étrangère s’affirme graduellement.
Cette inflexion se manifeste notamment par un rapprochement avec les pays arabes se déclinant par la multiplication des contacts, une fluidification des relations politiques et économiques, ou encore par l’adhésion de la Turquie à l’Organisation de la conférence islamique (OCI) en 1976.
Néanmoins, c’est au début des années 2000, avec l’accession du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, qu’un remarquable approfondissement des relations avec les pays de son environnement géopolitique immédiat se manifeste.
Ces évolutions ont été interprétées à travers de multiples prismes :
– une approche confessionnaliste : l’islam politique aux fondements de l’AKP serait la cause principale de ce rapprochement,
– des relations internationales comprises comme un jeu à somme nulle : les tensions avec l’Union européenne (UE) qui contraindraient la Turquie à réorienter sa politique étrangère vers le Moyen-Orient,
– une lecture historiciste de la politique étrangère turque avec l’utilisation récurrente du concept de « néo-ottomanisme ».
Ces grilles de lecture prises séparément ne peuvent néanmoins pas permettre de comprendre la complexité des évolutions entre la Turquie et son environnement régional et international…


