Notes / Sécurité humaine
15 juin 2017
Collaboration disruptive dans l’humanitaire. Peut-on prévoir les transformations de l’action sociale et humanitaire ?
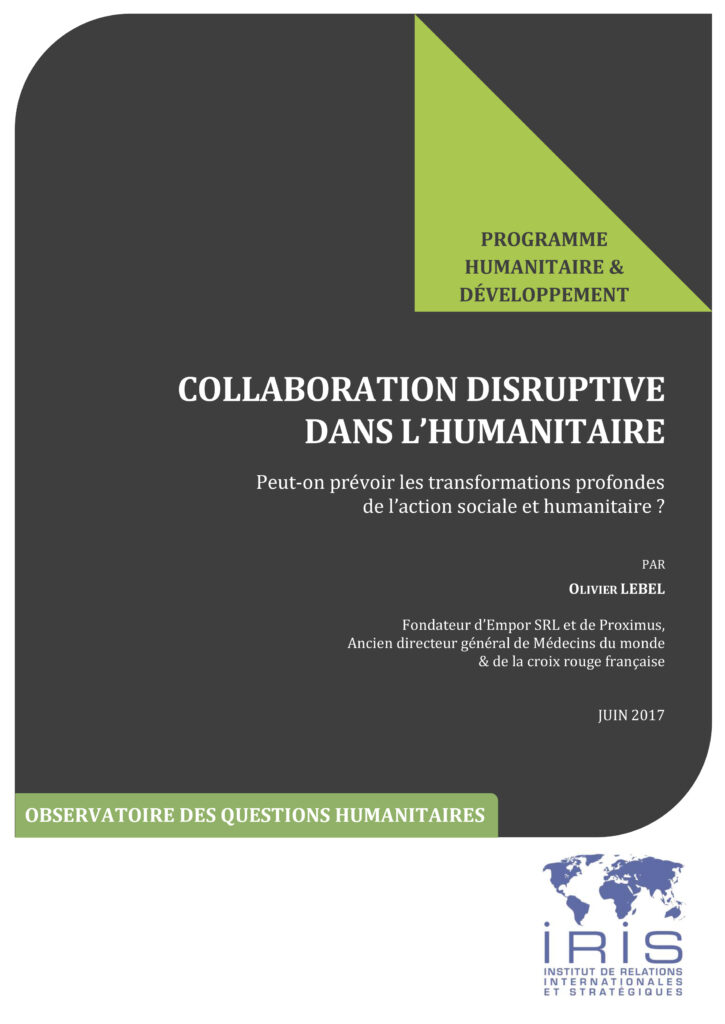
De nombreux auteurs ont souligné le fait que l’action humanitaire, née dans les années 1970 et 80 avec le mouvement sans frontiériste, avait maintenant atteint ses limites ; sans parler des mouvements “dunantistes” qui ont donné lieu soit au Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, soit aux énormes soit-disantes “ONG”, telles que Care, Oxfam ou Save the Children (voir par exemple Ryfman or Mattei).
Les critiques vont de la dépendance aux subventions et aux politiques publiques (Brauman), au changement profond de la situation internationale (Kent & al.) ; en passant par les risques majeurs (Donini, Maxwell) ; la fragmentation ; la volatilité ou le coût d’obtention des financements (Picciotto) ; l’inconstance ou le manque de mesure d’impact (Riddell) ; la nécessité de travailler avec les entreprises (Daccord) ou les forces armées (Kent ibid.) ; le non-respect des conventions internationales (Pilar) ; la taille ou la concurrence excessives (Weiss) ; l’inadéquation de la gouvernance (Lebel) ; ou, plus largement, l’incapacité d’adaptation, les organisations étant alors comparées aux dinosaures (Kayser, Budinic).
En réponse aux critiques, les agences internationales ont développé tout un système de reporting, de normes et de critères. Pourtant, au lieu d’améliorer la situation, certains auteurs expliquent que ces « compliance criteria » tuent l’innovation et le leadership (Buchanan-Smith, Scriven)
Globalement, alors que l’action humanitaire est ordinairement considérée comme indispensable pour sauver des vies, la manière dont elle est menée donne lieu à un large débat. Les auteurs appellent à un changement profond dans les comportements humanitaires (Mattei ou Kent & al. pour une revue des critiques, ainsi que pour des recommandations de changements). Le présent article présente une nouvelle méthode disruptive.

