Notes / Europe, Union européenne, OTAN
6 janvier 2021
Pour un nouveau cadre institutionnel de la politique de sécurité et de défense commune : la mise en place d’un Conseil de sécurité européen
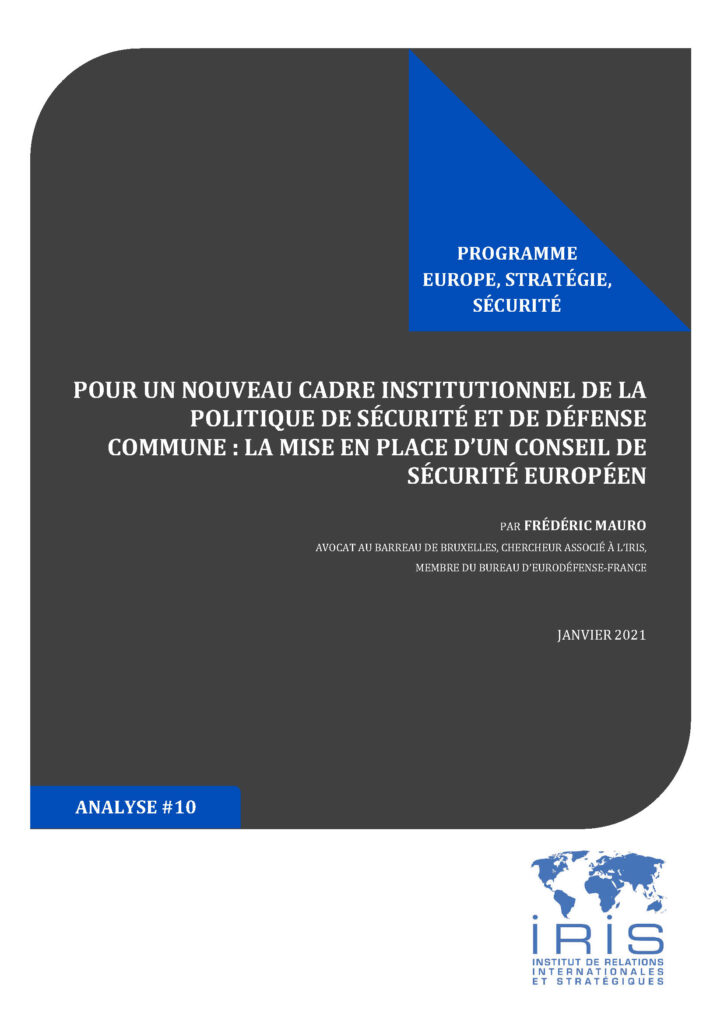
Le cadre institutionnel qui régit actuellement la politique (européenne) de sécurité et de défense commune (PSDC) a été mis en place dans la décennie qui va de la déclaration de Saint-Malo, le 4 décembre 1998, jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Il repose sur cinq grands principes : la subordination de la politique de défense à la politique étrangère (PESC) ; le caractère intergouvernemental de ces deux politiques, marqué par l’omniprésence de la règle de l’unanimité et la mise à l’écart des organes communautaires que sont le Parlement et la Commission ; une claire division du travail entre la PSDC et l’OTAN, la première étant chargée de la gestion des crises dans le voisinage de l’Europe quand les Américains ne veulent pas intervenir, la seconde étant la défense collective (y compris par des armes nucléaires) du territoire de l’Europe avec les Américains ; la « progressivité » de la mise en place de la PSDC au travers d’une convergence graduelle des paramètres de la coopération structurée permanente (CSP), processus intégratif censé produire la « capacité opérationnelle » nécessaire à la mise en oeuvre de la politique de défense ; enfin l’approche instrumentale ou « pragmatique », c’est-à-dire l’idée que la multiplication des instruments (Agence européenne de défense, état-major de l’Union européenne, etc.) susciterait l’intention de s’en servir, rendant ce faisant la PSDC opérationnelle.
Vingt-deux ans après Saint-Malo, onze ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le constat s’impose : ni la PESC ni la PSDC n’ont eu les résultats escomptés, pourtant énoncés avec une grande économie de mots en 1998 : « l’Union européenne doit pouvoir être en mesure de jouer tout son rôle sur la scène internationale ». Certes, il y a bien eu quelques succès qu’il ne faut pas minorer, tels que la négociation du traité sur le nucléaire iranien, ou les sanctions vis-à-vis de la Russie qui ont conduit certains pays, dont la France, à renoncer à d’importants contrats d’armement sur l’autel de l’intérêt général européen. Il y a bien eu également quelques opérations de crise qui ont été des succès comme Artémis en RDC ou Concordia en Macédoine. Mais en matière de politique étrangère depuis 2003 et l’invasion de l’Irak par les États-Unis, les États membres de l’Union ont apporté davantage de témoignages de division que de preuves d’unité et en matière de défense, ils ont été incapables de gérer les crises dans leur voisinage. Et pour cause, comme le relève sobrement le premier examen annuel coordonné de défense qui vient d’être publié : « le niveau d’ambition militaire de l’UE pour la PSDC est actuellement inatteignable (…) »…

