Notes / Asia Focus
19 décembre 2019
Le Tibet : enjeux historiques et mémoriels pour les temps futurs
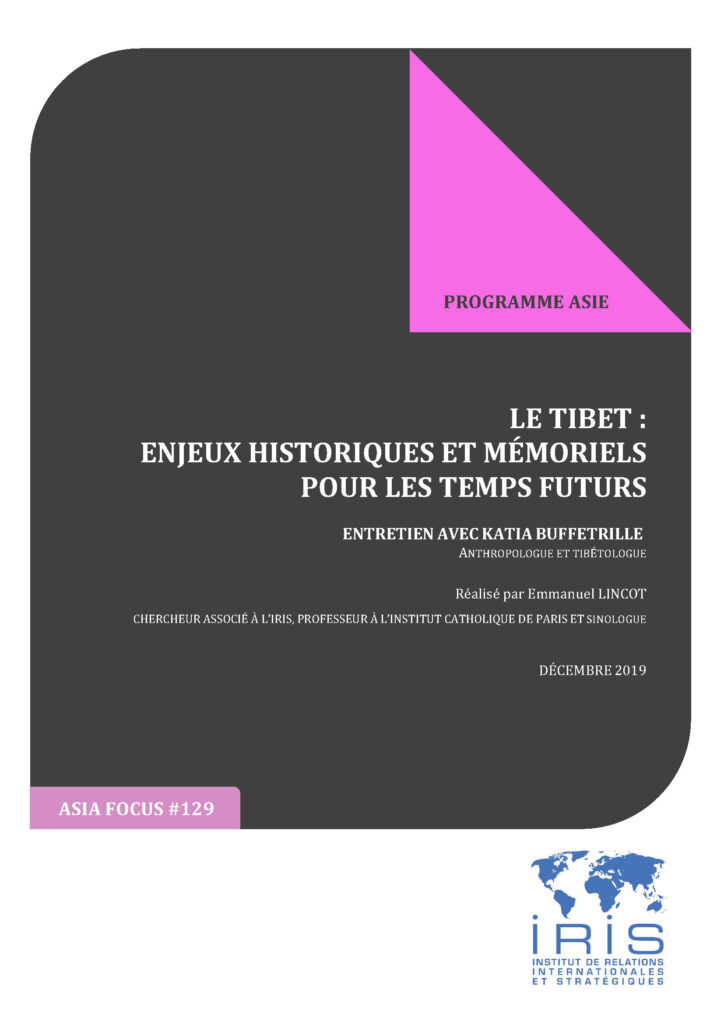
EMMANUEL LINCOT : Votre ouvrage présente une synthèse remarquable sur une période méconnue de l’histoire tibétaine coïncidant avec celle, chinoise, des dynasties Ming et Qing. En quoi considérez-vous que cette période est charnière ?
KATIA BUFFETRILLE : En 1642, le Ve Dalaï-Lama reçoit des mains de son disciple, le chef Qoshot Gushri Khan, les territoires du Tibet central et occidental qu’il vient de conquérir. Le hiérarque devient alors le premier Dalaï-Lama à exercer un pouvoir spirituel et aussi temporel. À la même époque, la dynastie chinoise des Ming qui régnait sur la Chine depuis le XIVe siècle est sur son déclin et la dynastie mandchoue des Qing prend le pouvoir en 1644. Pour le Tibet, le XVIIe siècle est effectivement une période cruciale, non seulement politiquement, mais aussi dans de nombreux autres domaines. Le Tibet est alors partiellement réunifié pour la première fois depuis le XIIIe siècle et va connaître une grande stabilité politique. Les personnalités hors du commun du Ve Dalaï-Lama, Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1682), mais aussi celle de l’un de ses régents, Sangye Gyatso (1653-1705), vont être décisives. Le hiérarque instaure un système particulier de gouvernement fondé sur l’union de l’autorité spirituelle et du pouvoir temporal qui, plus tard, au XVIIIe siècle sera doté de nouvelles structures gouvernementales qui perdureront quasiment en l’état jusqu’à l’invasion chinoise des années 1950…


