Notes / Observatoire géopolitique du religieux
27 mars 2019
Les partis religieux en Israël
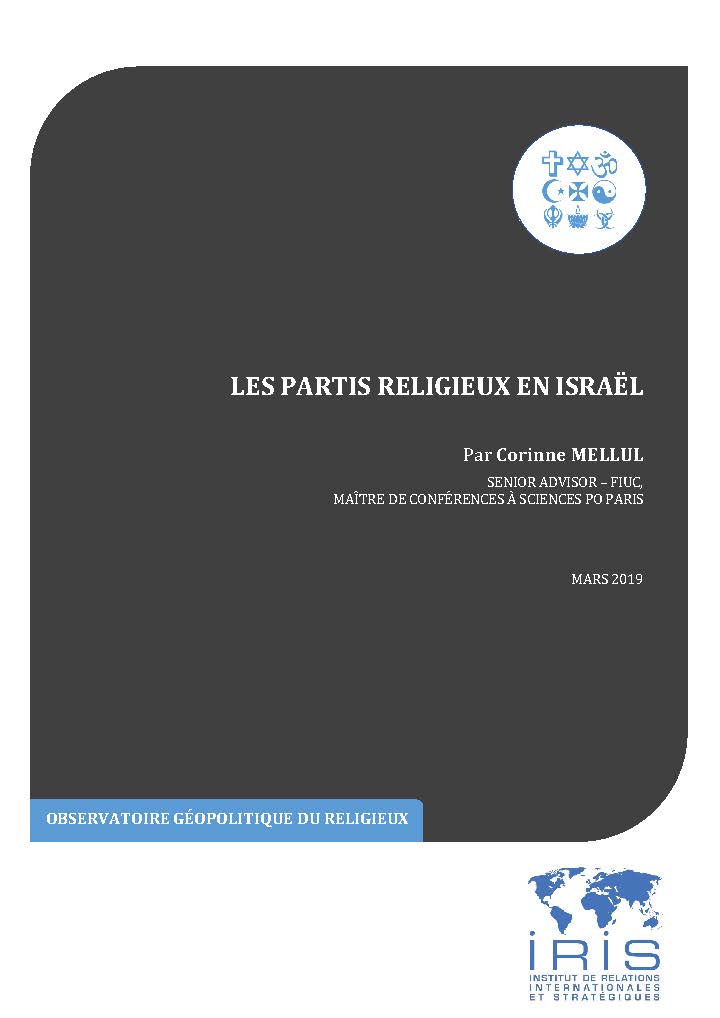
Le sionisme politique qui fut l’idéologie fondatrice de l’État hébreu en 1948 était très majoritairement laïc. En son sein, les courants religieux dans la période pré-étatique avaient été cantonnés à un rôle de réaction aux initiatives des dirigeants laïcs, dont ils avaient accepté le leadership en échange d’un engagement à préserver les principes religieux essentiels dans le futur État. Depuis la naissance d’Israël, la nature de la relation entre État et religion n’a cessé d’être débattue, mais Israël ne s’est à un aucun moment positionné – et encore moins revendiqué – comme État théocratique. Les partis religieux, largement minoritaires jusqu’à nos jours, ont certes fait partie de la plupart des gouvernements de coalition qui se sont succédé à partir de 1949, mais n’ont commencé à jouer un rôle déterminant que vers la fin des années 1980.
Ces partis ont, depuis, acquis une influence croissante dans la politique israélienne. Sur les cinq partis qui forment l’actuelle coalition gouvernementale de droite (Likoud, Koulanou, Shas, le Foyer juif et Judaïsme unifié de la Torah), trois sont d’identité religieuse : Shas, le parti ultra-orthodoxe sépharade fondé en 1984, le Foyer juif, parti orthodoxe sioniste et nationaliste, fondé en 2008 pour succéder au Parti national religieux, qui avait dominé la sphère politique religieuse depuis sa création en 1956 et avait fait partie de tous les gouvernements à partir de 1992, et Judaïsme unifié de la Torah, une alliance de deux partis ultra-orthodoxes ashkénazes née en 1992. Ces trois formations détiennent dans le gouvernement actuel des ministères qui comptent parmi les plus importants (intérieur pour Shas, justice, éducation et agriculture pour le Foyer juif, et santé de façon déléguée pour Judaïsme unifié de la Torah, le détenteur du titre de ministre étant le Premier ministre Benyamin Netanyahou). Si Netanyahou, qui en décembre 2018 a annoncé des élections anticipées pour le 9 avril 2019 dans le contexte des enquêtes multiples pour corruption qui le visent, est amené, comme l’indiquent les sondages, à former le prochain gouvernement d’Israël, il est à peu près certain que celui-ci reposera à nouveau sur une coalition de partis religieux et nationalistes.
Le pouvoir que détiennent donc aujourd’hui les partis religieux israéliens est sans précédent depuis la naissance de l’État en 1948, et n’aurait pu être imaginé par les fondateurs – tant idéologiques comme Theodor Herzl que politiques comme David Ben Gourion. Il y a trois facteurs à envisager pour comprendre cette évolution : la démographie, le système politique, et les mutations du contexte géopolitique depuis le début du XXIe siècle.

