Notes / Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique
10 septembre 2018
La réforme des institutions militaires en Turquie
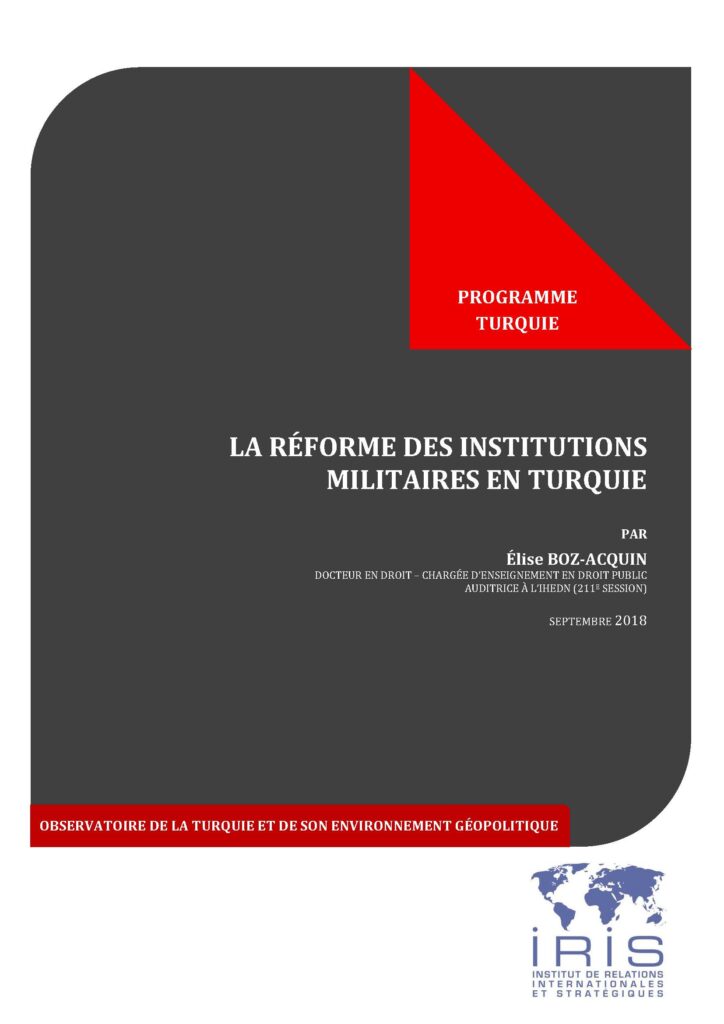
Depuis du régime parlementaire à partir de 1921, la Turquie a l’instauration connu trois putschs militaires qui se sont soldés, à chaque fois, par une réforme des institutions. Celles qui furent engagées, à la suite de la tentative de putsch avortée dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, s’inscrivent dans la continuité d’un tel modelage des institutions qui fut initié, pour la première fois, dès les années soixante par l’intervention militaire du 27 mai 1960 ; le Comité d’Union nationale composé de militaires, et ayant les pouvoirs de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), a fait voter la loi du 12 juin 1960 abrogeant certaines dispositions de la Constitution de 1924 et œuvré à la formation d’une nouvelle assemblée. L’adoption du bicamérisme est l’une des conséquences de cette intervention militaire2. Quelques années plus tard et en raison de l’instabilité politique de la fin des années soixante, le 12 mars 1971 le chef d’état-major des armées (CEMA) et les chefs d’états-majors ont poussé le chef du gouvernement à la démission afin que des élections nouvelles puissent permettre l’émergence d’un gouvernement au-dessus des partis. De 1971 à 1973 un certain nombre de réformes constitutionnelles sont imposées, notamment en vue de renforcer l’exécutif et limiter les droits et libertés individuels…

