Équilibres internationaux et mondialisation
Mars 2023
L’Indo-Pacifique, des visions plurielles entre convergences et dissonances
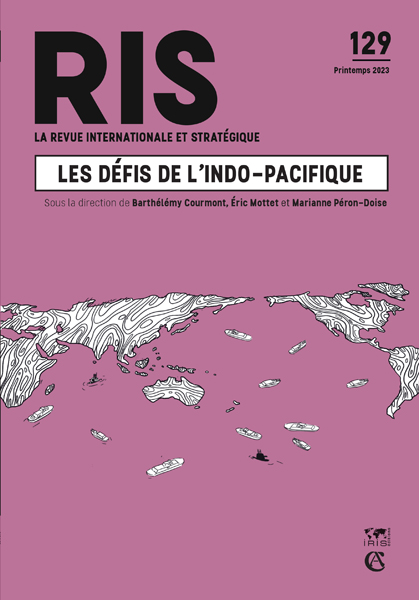 Les défis de l’Indo-Pacifique
Les défis de l’Indo-Pacifique
RIS 129 - Printemps 2023
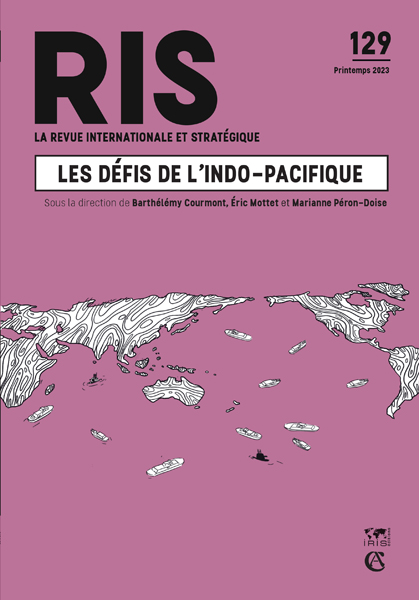
Introduction
Espace aux contours assez mal définis et sujets à diverses interprétations de la part des acteurs qui y accolent des stratégies, l’Indo-Pacifique s’est imposé au cours de la dernière décennie comme un enjeu majeur des relations internationales. Après le Japon, l’Australie et l’Inde, les États-Unis se sont exprimés pour la première fois en 2017 sur une stratégie Indo-Pacifique, avant d’être suivis par la France, plusieurs États européens – ainsi que l’Union européenne (UE) – et d’autres pays comme la Corée du Sud et, plus récemment, le Canada. Si l’Indo-Pacifique possède une signification géographique et désigne un vaste espace à dominante maritime couvrant les océans Indien et Pacifique, ses frontières restent floues, entre l’Afrique de l’Est et le continent américain. En revanche, l’Asie du Sud-Est et son cœur maritime, la mer de Chine méridionale, focalisent l’attention et en composent la « centralité stratégique ». Ce



