Notes / Observatoire géopolitique du religieux
6 juillet 2016
Le saint et grand Concile de l’orthodoxie face à la balkanisation des églises
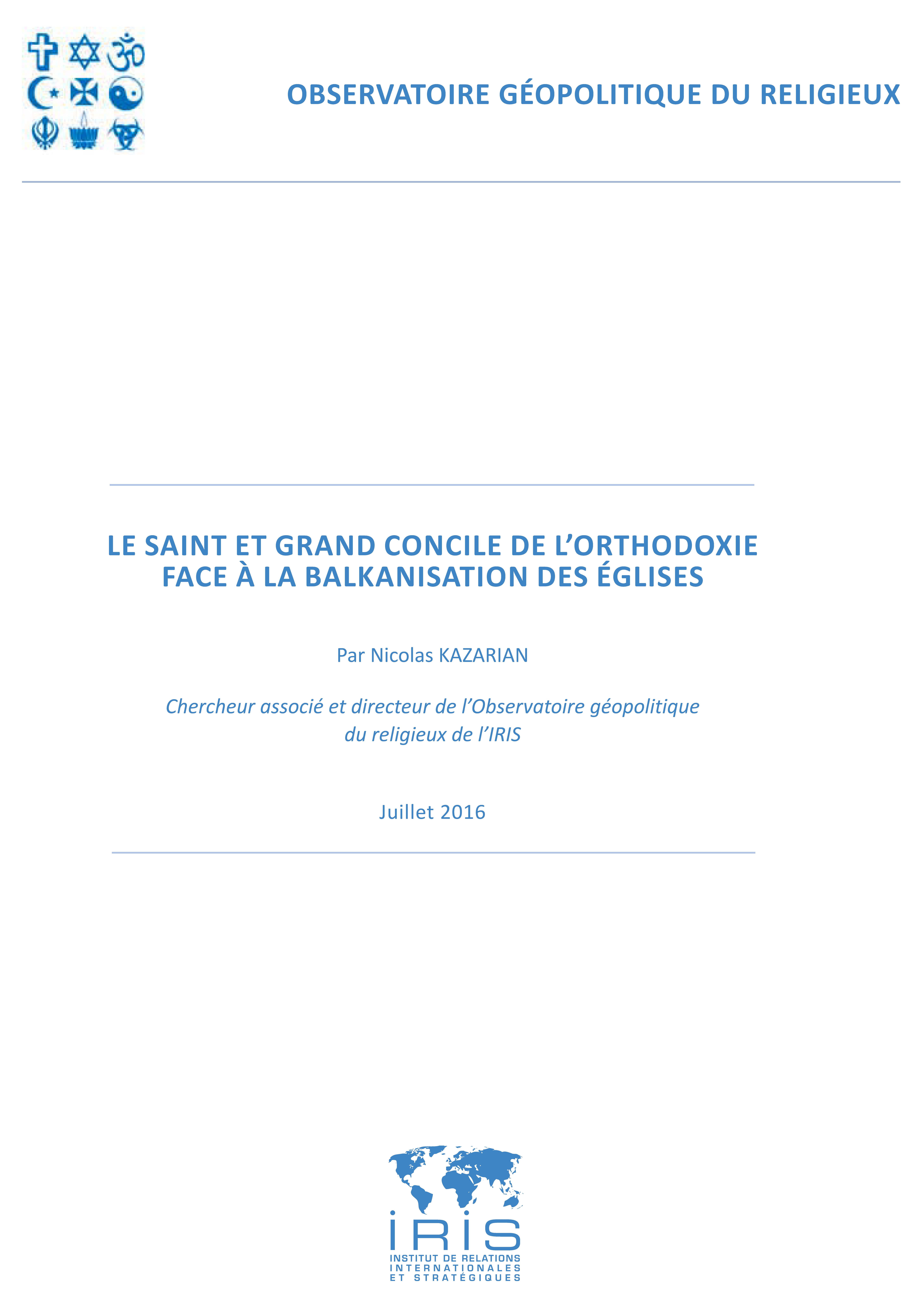
Le saint et grand Concile de l’Église orthodoxe s’est terminé dimanche 26 juin 2016. Après une semaine d’intenses travaux à l’Académie Orthodoxe de Crète, le Concile a produit pas moins de huit textes : un message, une encyclique, et les six documents préconciliaires à l’ordre du jour du Concile, moyennant certains amendements : jeûne, relation avec le reste du monde chrétien, autonomie, diaspora, mariage et mission de l’Église.
Outre ces éléments de fond, le Concile aura surtout profondément redessiné la carte de l’orthodoxie mondiale en redéfinissant les lignes de fracture de cet univers héritier de Byzance. L’idée d’un « Commonwealth byzantin » proposé par Dimitri Obolensky au début des années 1970 ressort très affaiblie de cette séquence conciliaire, au point que nous lui préférons l’expression de « balkanisation des Eglises ». En effet, ce qui devait servir de célébration de l’unité ecclésiale des quatorze Églises autocéphales (indépendantes) orthodoxes s’est transformé en affrontement. Quatre Patriarcats (Bulgarie, Géorgie, Russie et Antioche) ont annoncé quelques semaines, voire quelques jours avant l’ouverture du Concile, qu’ils ne s’y rendraient pas, pour des raisons que nous détaillerons un peu plus bas. Ce groupe demandait au Patriarcat de Constantinople, première dans la communion (fédération) des Églises orthodoxes et assurant la présidence du Concile, de le remettre à une date ultérieure, une fois que les problèmes soulevés auront été résolus. Pour le Patriarche oecuménique Bartholomée, primus inter pares (premier parmi les égaux) de l’Église orthodoxe, la convocation du Concile était une décision collective prise en janvier 2016 au cours de la rencontre des primats de l’Église orthodoxe, seule une réunion équivalente était en mesure de l’annuler.
Le Concile a donc bel et bien eu lieu. Son format était réduit à la présence de dix Églises autocéphales orthodoxes. Les délégations, composées par vingt-quatre évêques membres, étaient présidées par les primats de ces Églises. Plus de cent cinquante évêques étaient présents. Il s’agissait du premier concile de ce genre pour l’Église orthodoxe depuis 1200 ans et notamment depuis le schisme des Églises d’Orient et d’Occident en 1054. Il marque à bien des égards un retour de l’orthodoxie dans l’Histoire, à la suite d’un 20e siècle marqué par les persécutions, l’athéisme, l’exile et les nombreux conflits armés, dont certains font encore rage, notamment au Moyen-Orient. Le réveil de l’orthodoxie sur les cendres du totalitarisme, porté par la montée en puissance de sa diaspora, explique aussi le renforcement du prisme nationaliste, comme la reprise des conditions irrédentistes de la fin du 19e siècle qui avaient accompagné la naissance de nouveaux États dans le Sud-Est européen par la création de nouvelles Églises.

