10.07.2024
Nouvelles pratiques dans le financement des ONG : facilitateur d’émancipation ou effet d’aubaine ?
Interview
22 avril 2022
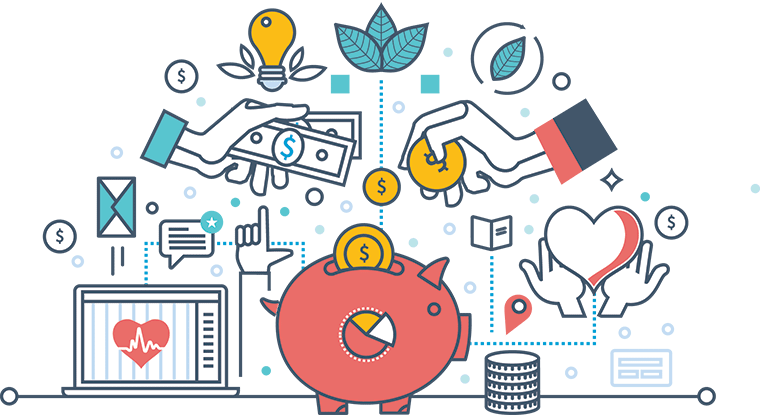
Alors que les conflits en Ukraine et en Afghanistan ont induit un certain regain d’exposition de l’humanitaire dans le débat public, quel impact ces crises ont-elles sur le financement des ONG, alors que celles-ci témoignent d’un intérêt grandissant pour les levées de fonds via l’émission de titres associatifs solidaires. Que représentent ces nouvelles sources de financements pour l’aide internationale ? Quels sont les avantages de ces nouveaux acteurs par rapport aux financements institutionnels classiques, et est-ce viable ? Entretien avec Kevin Goldberg, directeur général de l’ONG Solidarités International. Propos recueillis par Magali Chelpi-den Hamer, chercheuse à l’IRIS, en charge du Programme Humanitaire et Développement.
Il y a quelques semaines, l’ONG que vous représentez a levé 3 millions d’euros sous forme de titres associatifs solidaires grâce à une solution de financement arrangée et placée par le Crédit coopératif. C’est la première fois que Solidarités International utilise un tel mécanisme. Cette pratique n’étant pas nouvelle dans le monde des ONG, pourquoi vous y être engagé maintenant ? Qu’en attendez-vous précisément ? Et pourriez-vous nous expliquer ce que permet ce type de financement par rapport aux financements institutionnels classiques ?
Lever des fonds via l’émission de titres associatifs est un dispositif qui existe en droit français depuis le milieu des années 1980. Il y a eu un regain d’intérêt en 2014 grâce à une loi sur l’économie sociale et solidaire qui en a simplifié l’usage. Depuis lors, une trentaine d’associations y ont eu recours, dont certaines ONG comme ACTED ou ALIMA. Solidarités International leur a simplement emboîté le pas. Nous avons décidé d’utiliser ce dispositif pour nous donner plus d’air. Comme beaucoup d’organisations humanitaires, nous dépendons principalement des financements publics institutionnels pour nos activités, or ce type de financements dégage une marge brute faible qui rend difficile le fait de faire des investissements sur le long terme.
Le mécanisme des titres associatifs solidaires nous permet ainsi de financer des investissements pluriannuels. Concrètement, le dispositif s’apparente à un emprunt, et non à un don ou une subvention. Un montant nous est alloué, on paie un taux d’intérêt sur ce montant, et on doit à terme le rembourser. C’est un remboursement in fine, ce qui veut dire qu’on ne rembourse le capital qu’à la fin de la durée convenue. 7 ans dans notre cas, ce qui permet d’avoir un retour sur investissement. Quand un emprunt classique aurait fait peser sur nous le poids du remboursement annuel du capital, l’intérêt de passer par l’émission de titres associatifs est que cela permet de dégager des liquidités pour financer autre chose. Les intérêts, eux, sont remboursés régulièrement. Nous avons choisi un taux fixe, mais certaines associations préfèrent les taux variables et parfois choisissent d’ajuster les taux, en fonction du niveau de réussite de leurs objectifs d’impact. Sur la forme, ce dispositif financier se rapproche des pratiques des start-up quand elles font un tour de table pour aller chercher des investisseurs. Cela permet donc aussi de trouver de nouveaux partenaires. Il est important de signaler que le recours aux titres associatifs n’impacte aucunement la gouvernance de notre association. Cela n’ouvre aucun droit d’entrée au Conseil d’administration et nous ne devons rendre des comptes que sur notre santé financière et pas sur nos orientations stratégiques qui restent prises de manière totalement indépendante.
Qui sont ces acteurs financiers privés qui cherchent à se positionner dans le système de l’aide internationale ? Est-ce un effet de mode dû à l’Agenda 2030 que les investisseurs ne peuvent finalement plus éviter actuellement, ou est-ce une tendance pérenne ?
Ce sont principalement des fonds à impact qui choisissent d’investir dans des associations de solidarité internationale. Par rapport à un investisseur classique, ces fonds vont s’intéresser à des opérations financières orientées vers des projets à fort impact social ou environnemental, généralement avec un retour sur investissement plus faible que ce qu’un investisseur classique serait en droit d’attendre. Cela reste un pari, car il peut bien sûr arriver que les associations rencontrent des problèmes pour rembourser, mais le mécanisme reste plutôt protecteur pour toutes les parties.
Sur la question de l’effet de mode, on peut en effet se poser la question de l’usage de la notion d’impact et des ODD par les fonds d’investissement. Il y a plusieurs choses à dire ici. D’une part, on note une explosion des fonds « durables », « responsables » ou encore « à impact » en France et à l’étranger, et comme ces termes sont plus ou moins bien encadrés, cela peut créer une certaine confusion. Il est donc important de définir de quoi on parle. Pour moi, un fonds à impact reflète bien sûr un choix d’investissement dans des activités qui génèrent un impact positif sur l’environnement et sur la société, mais aussi un choix de rentabilité inférieure aux investissements classiques.
D’autre part, on ne peut pas éviter de s’interroger sur la course actuelle au label durable et sur la multiplicité des fonds étiquetés comme tels. Certaines entreprises classiques sont très bien notées (ESG++, c’est-à-dire qu’elles sont censées respecter certains critères liés à l’environnement, au social et à la gouvernance) et pourtant on voit qu’elles ne sont pas à l’abri d’un scandale social ou environnemental lié à la course aux profits. On peut parfois se retrouver en grand écart entre ce qui est annoncé sur les plaquettes des fonds et ce qui est réellement fait en termes de pratiques socialement responsables.
Pour revenir aux fonds à impact, il faut différencier, je pense, entre ce qui relève du financement des associations et ce qui relève de l’entreprise sociale. Une entreprise sociale vend un service ou des biens à porteurs d’impact positif qui lui permettent d’accroître ses revenus dans une logique de croissance. Elle est donc susceptible d’attirer des investisseurs intéressés par des prises de participation. L’association n’a pas de capital à diviser entre actionnaires, donc la prise de participation de tiers ne peut pas se faire comme avec une entreprise sociale, d’où l’intérêt de dispositifs tels que les titres associatifs.
L’Ukraine et l’Afghanistan devraient aspirer une grande part des financements d’urgence institutionnels en 2022 au détriment des crises qui sont moins médiatisées et sur des terrains plus lointains. Lever des fonds du secteur privé, lancer des campagnes de crowdfunding et faire du porte-à-porte peuvent partiellement permettre d’atténuer le choc. Quel est votre point de vue là-dessus ? Les impératifs de redevabilité diffèrent-ils en fonction de la source de financement ?
Plutôt qu’une diminution du niveau de financement des crises moins médiatiques, j’ai l’espoir que les conflits ukrainiens et afghans permettent une exposition plus forte de l’humanitaire dans le débat public, avec pour corollaire une volonté politique de faire augmenter l’enveloppe globale. Quand on regarde en arrière, on se rend compte en effet que les dépenses consacrées à l’aide humanitaire ont augmenté lors des nouvelles crises très médiatisées. Il y a cependant bien des effets d’aspiration d’une crise à l’autre, et on a toutes les raisons de craindre que les contextes déjà sous-financés (comme le Myanmar, Haïti, le Soudan du Sud, etc.) soient par ricochet affectés par la crise ukrainienne.
Ce que montre en soi cette crise, c’est aussi que le niveau global des aides publiques institutionnelles n’est pas adapté à l’ampleur et au nombre de crises, et qu’il reste fortement corrélé à la géopolitique. Une association comme la nôtre, qui est financée à plus de 70% par des fonds institutionnels directs, a par ailleurs tout intérêt à gagner en parallèle la confiance de donateurs particuliers pour pouvoir rester indépendante dans nos opérations. Convaincre nos donateurs individuels de la bonne utilisation des fonds qu’ils nous confient est un enjeu majeur. Pour cela ils doivent comprendre le mandat de notre organisation, nos mécanismes de contrôle interne et externe, nos modalités de gestion. Ces mécanismes nous obligent à être transparent. Nos frais de gestion oscillent entre 7 et 8%, ce qui est faible par rapport à d’autres acteurs de la solidarité internationale. Mais l’élément de fond à faire passer à nos donateurs individuels, c’est qu’il leur faut aussi accepter un certain lâcher-prise sur l’argent confié. Les quelques euros collectés par individu sont utilisés dans une logique d’aide humanitaire, parfois pour une crise spécifique, mais il me semble acceptable que leur choix s’arrête là. Que l’équipement acheté avec cet argent soit distribué à Lviv ou à la frontière avec la Moldavie ne doit à mon sens pas être un élément déterminant du don. Chacun son métier.
Pour autant, la redevabilité peut dépendre du type de donateurs. Parmi les donateurs institutionnels privés, une fondation a des idées précises sur le type de projet qu’elle veut soutenir. Elle a aussi généralement des ressources humaines qui peuvent analyser dans le détail le projet qu’elle veut financer. En contrepoint, un acteur individuel privé est plutôt un mécène, qui est prêt à soutenir l’organisation dans son ensemble. Au niveau des entreprises, ce que l’on essaie de faire, c’est de proposer à celles que l’on connaît bien de rentrer dans une logique de partenariat. L’idée est qu’elles nous fassent confiance en nous allouant un volume financier que nous allons utiliser dans le cadre d’un dispositif global, mais sans faire de fléchage préalable sur des dépenses en particulier. Nous rendons des comptes ensuite bien sûr, mais on se donne de la flexibilité. Trop de reporting est en effet contreproductif, en témoigne la lourdeur administrative et financière des procédures internes de contrôle dans la gestion des fonds institutionnels publics. Il reste nécessaire de communiquer sur ce qui est fait, notamment pour ajuster les programmes au gré des changements de contextes, mais il faut trouver le bon dosage.
La France a une autre culture philanthropique que les pays anglo-saxons, notamment parce que l’État s’est toujours positionné comme un acteur de premier plan dans les actions de solidarité. Pour autant, on note que les gens ont de plus en plus envie d’aider directement, sans forcément se limiter aux actions de proximité. C’est plutôt une bonne nouvelle. À chaque nouvelle crise, l’impact médiatique et les émotions suscitées restent les leviers principaux d’activation de la philanthropie. Pour les associations de solidarité internationale, l’enjeu est donc d’arriver à utiliser le moment émotionnel comme un moment d’éducation aux problématiques internationales. Quelle que soit l’origine des personnes impactées.